Entretien avec un archéologue…
Dominique Garcia, Président de l’INRAP depuis 2016, est archéologue, spécialiste de l’archéologie de terrain en France mais aussi en Syrie, en Italie et en Grèce. A l’issue de la soutenance de sa thèse axée sur la zone de contact entre Ibères et Ligures, celui-ci a été recruté comme maître de conférences au sein du département d’histoire, à l’université d’Aix-en-Provence. Il est élu professeur de chaire d’Antiquités nationales en 2002 puis à l’Institut universitaire de France en 2011. Par ailleurs, il est l’auteur de nombreux ouvrages, pour ne citer que les trois derniers :
– Archéologie des migrations, Paris, La Découverte/Inrap, 2017, 390 p. (direction de l’ouvrage en coll. avec Hervé Le Bras).
– La Protohistoire de la France, Paris, éditions Hermann, 2018, 538 p. (direction de l’ouvrage en coll. avec Jean Guilaine).
– Une histoire des civilisations. Comment l’archéologie bouleverse nos connaissances, Paris, La Découverte/Inrap, 2018, 603 p. (direction de l’ouvrage en coll. avec Jean-Paul Demoule et Alain Schnapp).
– Un ouvrage à paraître le 6 mai 2021: Les Gaulois, Paris, CNRS éditions, collection « A l’œil nu », 250 p. Un ouvrage qui présente une vision renouvelée des Gaulois et qui dresse un panorama culturel, économique et social des sociétés gauloises du VIe siècle avant JC à la conquête romaine, en croisant des données textuelles et en développant une approche anthropologique. La visée de cet ouvrage est de montrer comment les données archéologiques ont permis de réviser la vision que nous avions « de nos ancêtres les Gaulois » et de leur redonner une vraie place dans le discours contemporain.
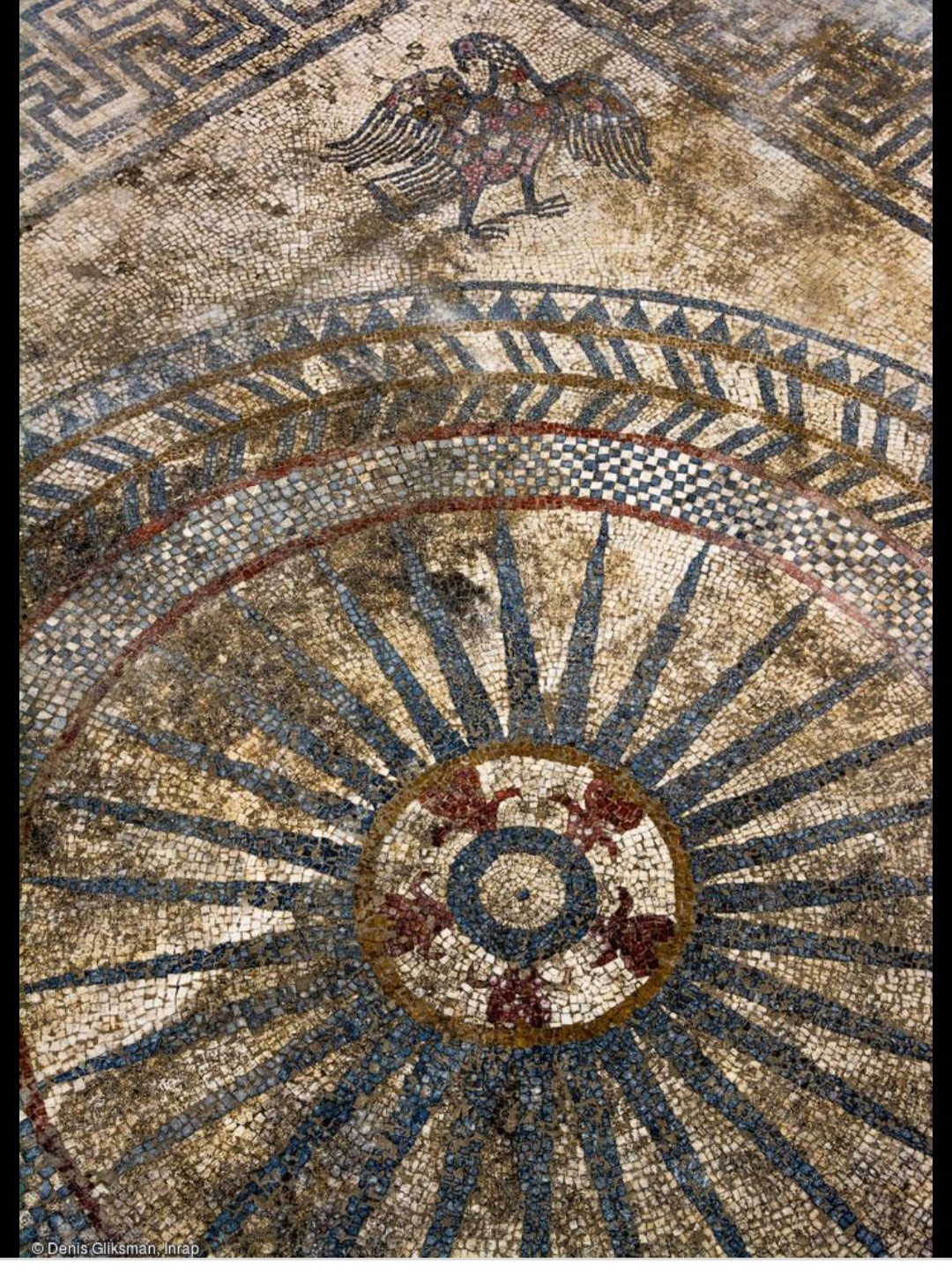 [/© Inrap/]
1. L’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives prend naissance le 1er février 2002. Pouvons-nous revenir brièvement sur le contexte de sa mise en place et sur ses objectifs ? L’archéologie préventive représente-t-elle une rupture ou une continuité avec l’archéologie dite « de sauvetage » ?
Dominique GARCIA : La loi sur l’archéologie préventive est votée en 2001, l’INRAP a été créé en 2002 mais l’histoire de l’archéologie de sauvetage et préventive est plus ancienne. Celle-ci date de l’après-guerre, de la période des Trente Glorieuses durant lesquelles la France est aménagée de manière profonde. Durant cette période, le patrimoine archéologique subit les contre-coups de cet aménagement du territoire. Ces travaux mettent au jour, -parfois brutalement ! – des vestiges archéologiques. Dès 1967, notamment à Marseille, Lyon et Paris se développe l’archéologie de « sauvetage » : les archéologues interviennent pour sauver un maximum de vestiges lors des activités de construction. Dans les années 1970 et les années 1980, énormément de vestiges sont cependant détruits. Dans les années 1990, plus d’archéologues sont formés et on prend davantage conscience de l’intérêt de sauvegarder le patrimoine, d’où la naissance progressive de l’archéologie préventive.
Celle-ci concilie deux actions importantes de l’État : l’aménagement du territoire et la conservation du patrimoine. À ce titre, est créée la redevance archéologique préventive, c’est-à-dire que pour chaque projet de construction, l’aménageur paie une taxe qui permet aux archéologues de repérer les sites archéologiques, ceux-ci pratiquant des fouilles en préalable de l’aménagement. À partir de 2001 et surtout de 2002 avec la création de l’INRAP, on passe à cette notion d’archéologie préventive qui est la restitution du patrimoine par l’étude.
Les sites archéologiques ne sont plus sanctuarisés mais ils sont des ressources exploitées par les archéologues, ensuite le terrain est laissé libre à l’aménagement. Trois temps se dégagent : celui du diagnostic des sites, celui de l’intervention des archéologues, et celui où l’aménageur met en œuvre sa construction. Le principe repose sur la restitution par l’étude, ce qui signifie que l’archéologue fouille, publie, met en œuvre des expositions, dépose les objets dans les musées : le patrimoine n’est plus in situ, mais des archives sont produites et la connaissance est partagée. Les archéologues déchiffrent les vestiges découverts dans le sol, laissent ensuite le terrain libre et rédigent un rapport, une publication, une exposition, une conférence qui permettra de restituer, par l’étude, les vestiges archéologiques. Aujourd’hui en France, 700 km² sont aménagés chaque année. Les DRAC prescrivent des diagnostics sur 20% de cette superficie. L’État peut ensuite prescrire une fouille archéologique, réalisée soit par l’INRAP, soit par un service des collectivités, soit par un opérateur privé. En France, chaque année, l’INRAP réalise environ 2000 diagnostics et 200 fouilles. Les sites protégés, classés comme celui de Vaison-La-Romaine sont des sites sauvegardés et servent pour des fouilles à long terme. Aujourd’hui, tout le territoire métropolitain et les territoires ultramarins français sont fouillés au gré de l’aménagement de notre pays. Le territoire national devient un « grand site archéologique ».
2. L’archéologie aide à mieux comprendre les sociétés du passé et à construire un savoir sur le passé. Comment, en tant qu’archéologue, faites-vous parler ces vestiges ? Quelles méthodes scientifiques utilisez-vous et quels questionnements se dégagent, par exemple, pour déterminer une période ?
DG : La pratique de l’archéologie préventive a transformé les questionnements. Aujourd’hui, l’archéologue s’intéresse à l’évolution des paysages, à la mise en place des territoires, à l’exploitation des terroirs. Prenons l’exemple de la construction de la ligne à grande vitesse entre Paris et Marseille. Celle-ci évite des sites archéologiques importants mais la vallée du Rhône recueille des alluvions fouillées par des archéologues et qui ont permis d’analyser l’impact de l’homme sur le milieu. Les sédiments, les restes végétaux, les pollens sont étudiés afin de déterminer l’évolution des paysages, du climat, la manière dont l’homme a aménagé cet espace pendant plusieurs millénaires. Dans ce fond de vallée, nous avons retrouvé les traces des déboisements au Néolithique pour mettre en place les cultures et permettre la sédentarisation de l’homme. Un autre exemple, celui de la fouille des tombes. Auparavant, un archéologue s’intéressait aux objets trouvés (vases, objets précieux…), ensuite son intérêt s’est porté sur l’architecture. Ce n’est que dans les années 1980, que s’est développée une anthropologie funéraire, donc ce qui devient central c’est le défunt. Les archéologues travaillent avec des anthropologues afin d’établir des courbes démographiques, d’identifier des traces de handicap, de maladie, d’avoir une approche plus globale pour étudier les populations passées. Aujourd’hui, une fouille est un laboratoire à ciel ouvert. Les questionnements se dégagent à la lumière des vestiges mis au jour.
3. L’archéologie étudie les différentes civilisations à partir des traces matérielles issues des fouilles. L’INRAP propose deux outils à la disposition des enseignants, le premier, Archéozoom permettant de géolocaliser les sites fouillés, et le second, la collection des atlas archéologiques destinée à comprendre un territoire à travers les découvertes archéologiques. En vous appuyant sur un exemple, pourriez-vous nous expliquer l’intérêt didactique et pédagogique de ces outils ?
DG : Archéozoom permet de localiser l’ensemble des fouilles réalisées par l’INRAP. C’est un instrument simple mais qui permet de toucher chaque individu, de montrer que l’histoire est partout. Un collégien ou un lycéen, grâce à Archéozoom, voit qu’il habite un paysage qui a une histoire, et dans lequel il est appelé à vivre et à évoluer.
Les atlas sont des synthèses, avec une mise en perspective des données d’un point de vue historique et topographique. Les documents sont analysés et interprétés, ce qui permet d’appréhender la fouille, la manière de dater et d’interpréter l’occupation d’un territoire.
4. L’INRAP met à la disposition des professeurs d’importantes ressources, du cycle 2 au lycée, afin d’enrichir leurs séquences d’enseignement. Des ressources qui permettent d’appréhender les périodes historiques de la Préhistoire à l’époque contemporaine, tout en se référant aux programmes d’enseignement nationaux. Si nous prenons l’exemple de l’étude des modes de vie au Néolithique, enseigné au cycle 3, notamment en 6ème, quelles ressources et pistes de travail proposez-vous ? Par ailleurs, pourquoi peut-on dire que les Gaulois « sont revisités » par l’archéologie ?
DG : L’INRAP est le plus important pourvoyeur de données, d’informations sur le temps long, qu’il est nécessaire de partager dans des revues scientifiques, dans des colloques. Concernant le Néolithique, et la période protohistorique jusqu’à la période gauloise, Jean-Paul Demoule a pu dire que c’étaient dix millénaires qui étaient oubliés. Ces archives du sol avaient été ignorées. Aujourd’hui, on nourrit ces « bibliothèques d’archives matérielles », traitées de manière thématique : les premiers campements, l’essor de l’espace villageois. On met en avant la culture matérielle, des vases, des traces de l’agriculture, des traces des migrations. Pour le Néolithique, on classe d’abord les vestiges d’habitat, ensuite les objets archéologiques notamment les céramiques, les silex. On développe un volet sur l’environnement, l’impact de l’homme sur les milieux. Des dossiers pédagogiques sont proposés par niveau, par cycle pour s’approprier ces données. On aborde aussi la métallurgie, l’âge du bronze avec les premières extractions de cuivre. La période gauloise est presqu’une première période de « mondialisation » puisque les populations locales, indigènes, dites autochtones entrent en contact avec les populations phéniciennes, étrusques, grecques et romaines. Les vestiges archéologiques permettent de voir ces premiers témoignages.
[/© Inrap/]
1. L’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives prend naissance le 1er février 2002. Pouvons-nous revenir brièvement sur le contexte de sa mise en place et sur ses objectifs ? L’archéologie préventive représente-t-elle une rupture ou une continuité avec l’archéologie dite « de sauvetage » ?
Dominique GARCIA : La loi sur l’archéologie préventive est votée en 2001, l’INRAP a été créé en 2002 mais l’histoire de l’archéologie de sauvetage et préventive est plus ancienne. Celle-ci date de l’après-guerre, de la période des Trente Glorieuses durant lesquelles la France est aménagée de manière profonde. Durant cette période, le patrimoine archéologique subit les contre-coups de cet aménagement du territoire. Ces travaux mettent au jour, -parfois brutalement ! – des vestiges archéologiques. Dès 1967, notamment à Marseille, Lyon et Paris se développe l’archéologie de « sauvetage » : les archéologues interviennent pour sauver un maximum de vestiges lors des activités de construction. Dans les années 1970 et les années 1980, énormément de vestiges sont cependant détruits. Dans les années 1990, plus d’archéologues sont formés et on prend davantage conscience de l’intérêt de sauvegarder le patrimoine, d’où la naissance progressive de l’archéologie préventive.
Celle-ci concilie deux actions importantes de l’État : l’aménagement du territoire et la conservation du patrimoine. À ce titre, est créée la redevance archéologique préventive, c’est-à-dire que pour chaque projet de construction, l’aménageur paie une taxe qui permet aux archéologues de repérer les sites archéologiques, ceux-ci pratiquant des fouilles en préalable de l’aménagement. À partir de 2001 et surtout de 2002 avec la création de l’INRAP, on passe à cette notion d’archéologie préventive qui est la restitution du patrimoine par l’étude.
Les sites archéologiques ne sont plus sanctuarisés mais ils sont des ressources exploitées par les archéologues, ensuite le terrain est laissé libre à l’aménagement. Trois temps se dégagent : celui du diagnostic des sites, celui de l’intervention des archéologues, et celui où l’aménageur met en œuvre sa construction. Le principe repose sur la restitution par l’étude, ce qui signifie que l’archéologue fouille, publie, met en œuvre des expositions, dépose les objets dans les musées : le patrimoine n’est plus in situ, mais des archives sont produites et la connaissance est partagée. Les archéologues déchiffrent les vestiges découverts dans le sol, laissent ensuite le terrain libre et rédigent un rapport, une publication, une exposition, une conférence qui permettra de restituer, par l’étude, les vestiges archéologiques. Aujourd’hui en France, 700 km² sont aménagés chaque année. Les DRAC prescrivent des diagnostics sur 20% de cette superficie. L’État peut ensuite prescrire une fouille archéologique, réalisée soit par l’INRAP, soit par un service des collectivités, soit par un opérateur privé. En France, chaque année, l’INRAP réalise environ 2000 diagnostics et 200 fouilles. Les sites protégés, classés comme celui de Vaison-La-Romaine sont des sites sauvegardés et servent pour des fouilles à long terme. Aujourd’hui, tout le territoire métropolitain et les territoires ultramarins français sont fouillés au gré de l’aménagement de notre pays. Le territoire national devient un « grand site archéologique ».
2. L’archéologie aide à mieux comprendre les sociétés du passé et à construire un savoir sur le passé. Comment, en tant qu’archéologue, faites-vous parler ces vestiges ? Quelles méthodes scientifiques utilisez-vous et quels questionnements se dégagent, par exemple, pour déterminer une période ?
DG : La pratique de l’archéologie préventive a transformé les questionnements. Aujourd’hui, l’archéologue s’intéresse à l’évolution des paysages, à la mise en place des territoires, à l’exploitation des terroirs. Prenons l’exemple de la construction de la ligne à grande vitesse entre Paris et Marseille. Celle-ci évite des sites archéologiques importants mais la vallée du Rhône recueille des alluvions fouillées par des archéologues et qui ont permis d’analyser l’impact de l’homme sur le milieu. Les sédiments, les restes végétaux, les pollens sont étudiés afin de déterminer l’évolution des paysages, du climat, la manière dont l’homme a aménagé cet espace pendant plusieurs millénaires. Dans ce fond de vallée, nous avons retrouvé les traces des déboisements au Néolithique pour mettre en place les cultures et permettre la sédentarisation de l’homme. Un autre exemple, celui de la fouille des tombes. Auparavant, un archéologue s’intéressait aux objets trouvés (vases, objets précieux…), ensuite son intérêt s’est porté sur l’architecture. Ce n’est que dans les années 1980, que s’est développée une anthropologie funéraire, donc ce qui devient central c’est le défunt. Les archéologues travaillent avec des anthropologues afin d’établir des courbes démographiques, d’identifier des traces de handicap, de maladie, d’avoir une approche plus globale pour étudier les populations passées. Aujourd’hui, une fouille est un laboratoire à ciel ouvert. Les questionnements se dégagent à la lumière des vestiges mis au jour.
3. L’archéologie étudie les différentes civilisations à partir des traces matérielles issues des fouilles. L’INRAP propose deux outils à la disposition des enseignants, le premier, Archéozoom permettant de géolocaliser les sites fouillés, et le second, la collection des atlas archéologiques destinée à comprendre un territoire à travers les découvertes archéologiques. En vous appuyant sur un exemple, pourriez-vous nous expliquer l’intérêt didactique et pédagogique de ces outils ?
DG : Archéozoom permet de localiser l’ensemble des fouilles réalisées par l’INRAP. C’est un instrument simple mais qui permet de toucher chaque individu, de montrer que l’histoire est partout. Un collégien ou un lycéen, grâce à Archéozoom, voit qu’il habite un paysage qui a une histoire, et dans lequel il est appelé à vivre et à évoluer.
Les atlas sont des synthèses, avec une mise en perspective des données d’un point de vue historique et topographique. Les documents sont analysés et interprétés, ce qui permet d’appréhender la fouille, la manière de dater et d’interpréter l’occupation d’un territoire.
4. L’INRAP met à la disposition des professeurs d’importantes ressources, du cycle 2 au lycée, afin d’enrichir leurs séquences d’enseignement. Des ressources qui permettent d’appréhender les périodes historiques de la Préhistoire à l’époque contemporaine, tout en se référant aux programmes d’enseignement nationaux. Si nous prenons l’exemple de l’étude des modes de vie au Néolithique, enseigné au cycle 3, notamment en 6ème, quelles ressources et pistes de travail proposez-vous ? Par ailleurs, pourquoi peut-on dire que les Gaulois « sont revisités » par l’archéologie ?
DG : L’INRAP est le plus important pourvoyeur de données, d’informations sur le temps long, qu’il est nécessaire de partager dans des revues scientifiques, dans des colloques. Concernant le Néolithique, et la période protohistorique jusqu’à la période gauloise, Jean-Paul Demoule a pu dire que c’étaient dix millénaires qui étaient oubliés. Ces archives du sol avaient été ignorées. Aujourd’hui, on nourrit ces « bibliothèques d’archives matérielles », traitées de manière thématique : les premiers campements, l’essor de l’espace villageois. On met en avant la culture matérielle, des vases, des traces de l’agriculture, des traces des migrations. Pour le Néolithique, on classe d’abord les vestiges d’habitat, ensuite les objets archéologiques notamment les céramiques, les silex. On développe un volet sur l’environnement, l’impact de l’homme sur les milieux. Des dossiers pédagogiques sont proposés par niveau, par cycle pour s’approprier ces données. On aborde aussi la métallurgie, l’âge du bronze avec les premières extractions de cuivre. La période gauloise est presqu’une première période de « mondialisation » puisque les populations locales, indigènes, dites autochtones entrent en contact avec les populations phéniciennes, étrusques, grecques et romaines. Les vestiges archéologiques permettent de voir ces premiers témoignages.
 [/© Inrap/]
5. L’histoire de l’esclavage a connu un renouvellement depuis les récentes fouilles aux Antilles, à la Réunion et en Afrique. Celles-ci nous renseignent sur le système esclavagiste et sont à la source de la construction de sa mémoire. Parlez-nous de l’exposition « De sucre et de sang », l’une des « archéocapsules » produites par l’INRAP.
DG : L’esclavage est une thématique transversale. Aujourd’hui, nos archéologues travaillent sur l’île de La Réunion, à Mayotte, dans les Antilles, en Guyane, dans une approche d’histoire globale. On aborde l’impact des sociétés européennes sur les populations amérindiennes et on identifie les traces de l’esclavage. Au-delà du pathos, il est important de mieux connaître ces lieux dans lesquels des populations asservies travaillaient : les champs de canne à sucre, les lieux de transformation, les lieux de vie, et d’inhumation. Aujourd’hui, on se doit se s’approprier cette histoire, de la partager et de la documenter de manière précise avant que les traces ne s’effacent.
Des outils pédagogiques comme une exposition légère (« l’archéocapsule ») consacrée à l’archéologie de l’esclavage colonial permet de « redonner une voix » à ceux qui en sont privés dans les archives écrites, opposant aux oublis volontaires et involontaires une incontestable matérialité.
[/© Inrap/]
5. L’histoire de l’esclavage a connu un renouvellement depuis les récentes fouilles aux Antilles, à la Réunion et en Afrique. Celles-ci nous renseignent sur le système esclavagiste et sont à la source de la construction de sa mémoire. Parlez-nous de l’exposition « De sucre et de sang », l’une des « archéocapsules » produites par l’INRAP.
DG : L’esclavage est une thématique transversale. Aujourd’hui, nos archéologues travaillent sur l’île de La Réunion, à Mayotte, dans les Antilles, en Guyane, dans une approche d’histoire globale. On aborde l’impact des sociétés européennes sur les populations amérindiennes et on identifie les traces de l’esclavage. Au-delà du pathos, il est important de mieux connaître ces lieux dans lesquels des populations asservies travaillaient : les champs de canne à sucre, les lieux de transformation, les lieux de vie, et d’inhumation. Aujourd’hui, on se doit se s’approprier cette histoire, de la partager et de la documenter de manière précise avant que les traces ne s’effacent.
Des outils pédagogiques comme une exposition légère (« l’archéocapsule ») consacrée à l’archéologie de l’esclavage colonial permet de « redonner une voix » à ceux qui en sont privés dans les archives écrites, opposant aux oublis volontaires et involontaires une incontestable matérialité.
 [/© Inrap /]
6. Les nombreuses fouilles effectuées par l’INRAP ont permis de découvrir de nombreux vestiges. Je pensais aux dernières découvertes dans l’amphithéâtre de Nîmes et à la nécropole antique aux portes de Narbonne. Comment un enseignant peut-il s’approprier ces découvertes ?
DG : Les deux sites sont intéressants. Le site de Narbonne était connu mais on ne connaissait rien de son occupation dans le détail. Certains sites comme celui de Nîmes ont été sanctuarisés mais on ne connaissait pas leur origine de façon précise. La ville de Nîmes a demandé à l’INRAP de fouiller l’amphithéâtre de Nîmes, ce qui a permis de retrouver des salles qui correspondent à des formes d’occupation plus anciennes que l’édifice de spectacle actuel. Un autre exemple, celui de Notre-Dame De Paris. Un monument connu, dramatiquement atteint par un incendie. Mais cet espace était peu ou pas documenté par les archéologues. Aujourd’hui, des historiens de l’art et des archéologues de l’INRAP travaillent sur ce site car le grand défi est de connaître la manière dont a été construite la cathédrale pour la restaurer au mieux et documenter ce que la reconstruction va masquer. Donc même les monuments visibles sur le paysage restent méconnus.
Avec Narbonne, nous abordons un dossier passionnant. Elle est présentée comme la « fille de Rome » mais on a du mal à identifier les traces de cette ville romaine. Les ressources essentielles de Narbonne sont liées à son rempart du Bas-Empire qui a été détruit sous l’Ancien Régime. Dans la sortie Sud de la ville, un projet immobilier a été initié il y a deux ans et l’État a prescrit une fouille préventive que l’INRAP a réalisée. Cela permis de fouiller 2000 tombes de la période romaine, des Ier et IIe siècles. Nous avons là une nécropole de la colonie romaine la plus ancienne avec un lot statistique important, près de 2000 défunts. La nécropole est placée en bordure de la Robine, qui est un bras fossile du fleuve Aude. Or, ces fleuves languedociens connaissent de fortes crues. Le cimetière de Narbonne a été régulièrement enseveli par des débordements de l’Aude, donc le cimetière est stratifié, ainsi les tombes sont bien conservées. On peut étudier les rites et les gestes funéraires sur une longue durée du monde romain, sur trois siècles. Narbonne et la région Occitanie aménagent un grand musée, le Narbo Via. Ce musée qui accueille les vestiges découverts sur le territoire narbonnais depuis plus d’un siècle rassemble également les vestiges de la nécropole de Narbonne. Donc, on n’aura pas uniquement un musée qui présente des objets, des pièces mais aussi un musée qui présentera en contexte une histoire, une lecture de la vie des Narbonnaises et des Narbonnais durant l’Antiquité : un bel outil pédagogique.
7. Les vestiges et les monuments du passé sont confrontés aux risques naturels ou d’origine humaine. Un défi difficile à relever est celui de la préservation des vestiges. J’aimerais que nous abordions la notion de patrimoine archéologique.
DG : C’est un sujet central et qui évolue. Jusqu’à l’avènement de l’archéologie préventive, nous étions persuadés que le patrimoine archéologique était uniquement représenté par les sites classés monuments historiques, gaulois, romains ou médiévaux. Ce patrimoine était une sorte d’îlots sanctuarisés dans nos paysages actuels. Aujourd’hui, l’archéologie englobe un patrimoine beaucoup plus large ; les vestiges classés, le territoire que nous occupons, mais également la mer, et ce, pour toutes les périodes. Un tiers des sites paléolithiques sont sous l’eau. Ces vestiges anciens nous permettent de reconsidérer nos limites spatiales et temporelles. Le patrimoine est composé par des objets, des modes de vie mais aussi des pollens qui décrivent les paysages et les climats. Donc cette notion d’objet et de patrimoine archéologiques a évolué. Notre patrimoine ne mérite pas d’être uniquement préservé, voire fossilisé ; il doit être enrichi et interrogé en permanence.
[/© Inrap /]
6. Les nombreuses fouilles effectuées par l’INRAP ont permis de découvrir de nombreux vestiges. Je pensais aux dernières découvertes dans l’amphithéâtre de Nîmes et à la nécropole antique aux portes de Narbonne. Comment un enseignant peut-il s’approprier ces découvertes ?
DG : Les deux sites sont intéressants. Le site de Narbonne était connu mais on ne connaissait rien de son occupation dans le détail. Certains sites comme celui de Nîmes ont été sanctuarisés mais on ne connaissait pas leur origine de façon précise. La ville de Nîmes a demandé à l’INRAP de fouiller l’amphithéâtre de Nîmes, ce qui a permis de retrouver des salles qui correspondent à des formes d’occupation plus anciennes que l’édifice de spectacle actuel. Un autre exemple, celui de Notre-Dame De Paris. Un monument connu, dramatiquement atteint par un incendie. Mais cet espace était peu ou pas documenté par les archéologues. Aujourd’hui, des historiens de l’art et des archéologues de l’INRAP travaillent sur ce site car le grand défi est de connaître la manière dont a été construite la cathédrale pour la restaurer au mieux et documenter ce que la reconstruction va masquer. Donc même les monuments visibles sur le paysage restent méconnus.
Avec Narbonne, nous abordons un dossier passionnant. Elle est présentée comme la « fille de Rome » mais on a du mal à identifier les traces de cette ville romaine. Les ressources essentielles de Narbonne sont liées à son rempart du Bas-Empire qui a été détruit sous l’Ancien Régime. Dans la sortie Sud de la ville, un projet immobilier a été initié il y a deux ans et l’État a prescrit une fouille préventive que l’INRAP a réalisée. Cela permis de fouiller 2000 tombes de la période romaine, des Ier et IIe siècles. Nous avons là une nécropole de la colonie romaine la plus ancienne avec un lot statistique important, près de 2000 défunts. La nécropole est placée en bordure de la Robine, qui est un bras fossile du fleuve Aude. Or, ces fleuves languedociens connaissent de fortes crues. Le cimetière de Narbonne a été régulièrement enseveli par des débordements de l’Aude, donc le cimetière est stratifié, ainsi les tombes sont bien conservées. On peut étudier les rites et les gestes funéraires sur une longue durée du monde romain, sur trois siècles. Narbonne et la région Occitanie aménagent un grand musée, le Narbo Via. Ce musée qui accueille les vestiges découverts sur le territoire narbonnais depuis plus d’un siècle rassemble également les vestiges de la nécropole de Narbonne. Donc, on n’aura pas uniquement un musée qui présente des objets, des pièces mais aussi un musée qui présentera en contexte une histoire, une lecture de la vie des Narbonnaises et des Narbonnais durant l’Antiquité : un bel outil pédagogique.
7. Les vestiges et les monuments du passé sont confrontés aux risques naturels ou d’origine humaine. Un défi difficile à relever est celui de la préservation des vestiges. J’aimerais que nous abordions la notion de patrimoine archéologique.
DG : C’est un sujet central et qui évolue. Jusqu’à l’avènement de l’archéologie préventive, nous étions persuadés que le patrimoine archéologique était uniquement représenté par les sites classés monuments historiques, gaulois, romains ou médiévaux. Ce patrimoine était une sorte d’îlots sanctuarisés dans nos paysages actuels. Aujourd’hui, l’archéologie englobe un patrimoine beaucoup plus large ; les vestiges classés, le territoire que nous occupons, mais également la mer, et ce, pour toutes les périodes. Un tiers des sites paléolithiques sont sous l’eau. Ces vestiges anciens nous permettent de reconsidérer nos limites spatiales et temporelles. Le patrimoine est composé par des objets, des modes de vie mais aussi des pollens qui décrivent les paysages et les climats. Donc cette notion d’objet et de patrimoine archéologiques a évolué. Notre patrimoine ne mérite pas d’être uniquement préservé, voire fossilisé ; il doit être enrichi et interrogé en permanence.
 [/© DR /]
8. La diffusion du savoir archéologique est primordiale. À ce titre, vous proposez une revue Archéopages. Archéologie et société. Pourrions-nous avoir des précisions sur cette revue scientifique ?
DG : Il s’agit là de notre mission de restitution par l’étude. L’archéologue n’est pas simplement celui qui fouille, qui étudie, c’est aussi celui qui transmet. Par exemple, nous coproduisons une exposition sur l’anthropocène et le Néolithique, du mois d’avril jusqu’en février 2022, au musée des Confluences à Lyon. La revue trimestrielle « Archéopages », elle, est une publication archéologique qui dépasse les éléments descriptifs pour aborder des thématiques sociétales qui sont, par exemple, la naissance des villages, l’archéologie de la santé, les terrains vagues, l’environnement, le climat. Pour chaque sujet, on fait dialoguer les archéologues avec des spécialistes des sciences humaines et sociales. On essaye de dépasser le cadre de l’objet pour répondre aux questions qui préoccupent les citoyens. Le grand défi de l’archéologie c’est de pouvoir partager et transmettre ; se questionner. L’archéologie n’a de sens que si, au-delà des fouilles et musées, on arrive à échanger et à partager ces données et une réflexion.
9. De nombreux musées comme celui de la Romanité à Nîmes ou Narbo Via à Narbonne développent un lien entre la recherche archéologique et la valorisation des vestiges. Pourriez-vous nous éclairer sur ce partenariat ?
DG : L’histoire des musées en France pourrait être résumée à deux musées parisiens. Le musée du Louvre est le plus grand musée du monde mais dans lequel nous ne trouvons que de rares vestiges de notre territoire. Il conserve et expose des découvertes de l’archéologie classique ou extra métropolitaine. En parallèle, nous pouvons citer le musée d’archéologie nationale à St- Germain- En- Laye fondé par Napoléon III, qui est un condensé de l’histoire de France à partir d’objets. Depuis une vingtaine d’années, naissent sur les territoires des musées dans des métropoles, dans des départements, dans des régions, qui recueillent les vestiges archéologiques issus de fouilles récentes et veulent raconter une histoire des territoires. Le musée restitue un contexte à ces objets. L’exemple de Nîmes souligne un concept, celui de la romanité. Il présente des vestiges gaulois puis montre comment les populations se sont acculturées et comment cette notion de romanité se manifeste. Le musée de Narbonne présente les vestiges découverts à Narbonne mais aussi la place du rôle portuaire de Narbonne dans l’Empire romain. Les musées ne se contentent pas d’être des lieux où l’on conserve des objets mais des espaces où l’on raconte une histoire singulière qui permet à chacun de se situer dans l’espace et dans le temps. Dans le cadre des parcours pédagogiques proposés par les musées, la scénographie permet de renouveler la vision qu’on a des sociétés anciennes. L’INRAP a également un partenariat avec le musée de Vix à Châtillon- Sur- Seine qui présente les restes de la princesse de Vix mais aussi avec une cinquantaine d’autres espaces muséographiques. L’archéologie est à voir par tous et partout.
10. Pour terminer cet entretien, une dernière question sur le métier d’archéologue, qui pourrait intéresser nos élèves dans le cadre de leur parcours d’orientation post-bac. Quels sont les différents parcours qui mènent aux métiers de l’archéologie ? Et selon vous, Dominique Garcia, pourquoi ce métier est-il si passionnant ?
DG : Quand on fait de l’archéologie, on se sent chanceux ! C’est avant tout un plaisir de découvrir et de partager de la connaissance. Aujourd’hui, dans un monde qui bouge, l’archéologie apporte des repères qui permettent à chacun de s’approprier le territoire, d’apprendre son histoire. J’ai commencé l’archéologie en Languedoc et, pour moi, faire de l’archéologie c’était aussi chercher à savoir ce qui se trouvait sous le château de mon village, quelle était l’histoire des villes grecques ou romaines à proximité ; me situer dans le paysage et dans l’histoire.
Programmer sa formation est beaucoup plus complexe. Il y a cinquante ans, un bon archéologue devait connaître le grec, le latin voire l’acadien. Plus tard, des connaissances en sciences de la terre ou en sciences de la vie étaient exigées. L’un des grands bouleversements de l’archéologie a été la prise en compte de l’anthropologie ; de nombreux archéologues ont des formations en médecine. Aujourd’hui, la génétique permet de réécrire l’histoire de nos sociétés. Mais les sciences de l’environnement sont aussi essentielles pour l’étude des graines, des pollens, des bois.
Si vous vous intéressez à l’Histoire, aux sociétés anciennes, on peut accéder à l’archéologie par différentes portes car les chantiers archéologiques, sont aujourd’hui des « laboratoires » qui mettent en relation différents spécialistes, qui collaborent et partagent leur savoir. Avec le développement des nouvelles technologies, nous avons besoin de données fiables pour modéliser, proposer des images en 3D. Donc il faut aimer les territoires, aimer l’Histoire mais aussi savoir innover et s’entourer.
Aujourd’hui, nous pouvons compter 5000 archéologues en France ; beaucoup vont partir à la retraite dans les dix ans qui viennent. Par ailleurs, des territoires nouveaux s’ouvrent comme celui de la mer…des champs nouveaux s’ouvrent comme l’archéologie spatiale. On ne sait pas tout ce que le passé nous réserve…
[/© DR /]
8. La diffusion du savoir archéologique est primordiale. À ce titre, vous proposez une revue Archéopages. Archéologie et société. Pourrions-nous avoir des précisions sur cette revue scientifique ?
DG : Il s’agit là de notre mission de restitution par l’étude. L’archéologue n’est pas simplement celui qui fouille, qui étudie, c’est aussi celui qui transmet. Par exemple, nous coproduisons une exposition sur l’anthropocène et le Néolithique, du mois d’avril jusqu’en février 2022, au musée des Confluences à Lyon. La revue trimestrielle « Archéopages », elle, est une publication archéologique qui dépasse les éléments descriptifs pour aborder des thématiques sociétales qui sont, par exemple, la naissance des villages, l’archéologie de la santé, les terrains vagues, l’environnement, le climat. Pour chaque sujet, on fait dialoguer les archéologues avec des spécialistes des sciences humaines et sociales. On essaye de dépasser le cadre de l’objet pour répondre aux questions qui préoccupent les citoyens. Le grand défi de l’archéologie c’est de pouvoir partager et transmettre ; se questionner. L’archéologie n’a de sens que si, au-delà des fouilles et musées, on arrive à échanger et à partager ces données et une réflexion.
9. De nombreux musées comme celui de la Romanité à Nîmes ou Narbo Via à Narbonne développent un lien entre la recherche archéologique et la valorisation des vestiges. Pourriez-vous nous éclairer sur ce partenariat ?
DG : L’histoire des musées en France pourrait être résumée à deux musées parisiens. Le musée du Louvre est le plus grand musée du monde mais dans lequel nous ne trouvons que de rares vestiges de notre territoire. Il conserve et expose des découvertes de l’archéologie classique ou extra métropolitaine. En parallèle, nous pouvons citer le musée d’archéologie nationale à St- Germain- En- Laye fondé par Napoléon III, qui est un condensé de l’histoire de France à partir d’objets. Depuis une vingtaine d’années, naissent sur les territoires des musées dans des métropoles, dans des départements, dans des régions, qui recueillent les vestiges archéologiques issus de fouilles récentes et veulent raconter une histoire des territoires. Le musée restitue un contexte à ces objets. L’exemple de Nîmes souligne un concept, celui de la romanité. Il présente des vestiges gaulois puis montre comment les populations se sont acculturées et comment cette notion de romanité se manifeste. Le musée de Narbonne présente les vestiges découverts à Narbonne mais aussi la place du rôle portuaire de Narbonne dans l’Empire romain. Les musées ne se contentent pas d’être des lieux où l’on conserve des objets mais des espaces où l’on raconte une histoire singulière qui permet à chacun de se situer dans l’espace et dans le temps. Dans le cadre des parcours pédagogiques proposés par les musées, la scénographie permet de renouveler la vision qu’on a des sociétés anciennes. L’INRAP a également un partenariat avec le musée de Vix à Châtillon- Sur- Seine qui présente les restes de la princesse de Vix mais aussi avec une cinquantaine d’autres espaces muséographiques. L’archéologie est à voir par tous et partout.
10. Pour terminer cet entretien, une dernière question sur le métier d’archéologue, qui pourrait intéresser nos élèves dans le cadre de leur parcours d’orientation post-bac. Quels sont les différents parcours qui mènent aux métiers de l’archéologie ? Et selon vous, Dominique Garcia, pourquoi ce métier est-il si passionnant ?
DG : Quand on fait de l’archéologie, on se sent chanceux ! C’est avant tout un plaisir de découvrir et de partager de la connaissance. Aujourd’hui, dans un monde qui bouge, l’archéologie apporte des repères qui permettent à chacun de s’approprier le territoire, d’apprendre son histoire. J’ai commencé l’archéologie en Languedoc et, pour moi, faire de l’archéologie c’était aussi chercher à savoir ce qui se trouvait sous le château de mon village, quelle était l’histoire des villes grecques ou romaines à proximité ; me situer dans le paysage et dans l’histoire.
Programmer sa formation est beaucoup plus complexe. Il y a cinquante ans, un bon archéologue devait connaître le grec, le latin voire l’acadien. Plus tard, des connaissances en sciences de la terre ou en sciences de la vie étaient exigées. L’un des grands bouleversements de l’archéologie a été la prise en compte de l’anthropologie ; de nombreux archéologues ont des formations en médecine. Aujourd’hui, la génétique permet de réécrire l’histoire de nos sociétés. Mais les sciences de l’environnement sont aussi essentielles pour l’étude des graines, des pollens, des bois.
Si vous vous intéressez à l’Histoire, aux sociétés anciennes, on peut accéder à l’archéologie par différentes portes car les chantiers archéologiques, sont aujourd’hui des « laboratoires » qui mettent en relation différents spécialistes, qui collaborent et partagent leur savoir. Avec le développement des nouvelles technologies, nous avons besoin de données fiables pour modéliser, proposer des images en 3D. Donc il faut aimer les territoires, aimer l’Histoire mais aussi savoir innover et s’entourer.
Aujourd’hui, nous pouvons compter 5000 archéologues en France ; beaucoup vont partir à la retraite dans les dix ans qui viennent. Par ailleurs, des territoires nouveaux s’ouvrent comme celui de la mer…des champs nouveaux s’ouvrent comme l’archéologie spatiale. On ne sait pas tout ce que le passé nous réserve…
 [/© Inrap /]
[/© Inrap /]



