Compte-rendu de la journée APHG du 7 novembre 2015 « La carte : un outil majeur pour expliquer le Monde, la France et l’Europe »
Samuel Depraz, maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3 et président de la Régionale de Lyon de l’APHG, assure la présentation de la journée, qui commence par une intervention d’Henry Dougier, fondateur des Éditions Autrement et des Ateliers Henry Dougier [2], et d’Aurélie Boissière, géographe-cartographe indépendante. [3]

Ils présentent Mappe, qui est plus qu’une marque : c’est un concept nouveau de livre-carte, associant une carte grand format qui, repliée, devient un livre de 32 pages. [4] Support pédagogique potentiel, les Mappes, lancées à l’automne 2015, combinent une cartographie de qualité sur grand format (la carte géante mesure 100 x 68 cm) et des textes rédigés par des spécialistes, en insistant sur la dimension humaine dans les espaces-clés du basculement du monde. L’exemple développé est celui de la première Mappe, celle de l’Amazonie. Le format n’affranchit pas de la contrainte ; elle persiste notamment au travers de difficultés d’impression par exemple. La dialectique sémiologique posée par Jacques Bertin entre la « carte à lire » (niveau de détail de l’information) et la « carte à voir » (efficacité de l’esthétique visuelle pour prendre en compte rapidement l’organisation générale de l’espace) perdure. Une carte géante n’est pas l’agrandissement d’une petite carte ; c’est une carte différente, qui doit garder une lecture d’ensemble possible, mais avec une démultiplication de la précision et du nombre des données.
La recherche, la sélection et la représentation des données en les combinant constituent le cœur de métier du cartographe. Même les informations a priori neutres et objectives posent problème, en particulier sur un tel format : il faut constituer un fond de carte précis (sans trop de « généralisation cartographique ») car même s’il sera recouvert il reste essentiel pour l’esthétique et la localisation. Chaque espace a ses propres contraintes : pour une carte de l’Himalaya, le relief est extrêmement complexe ; pour une carte de l’Amazonie, c’est l’infinité des cours d’eau qui est source de difficulté, non seulement à propos du tracé mais aussi de la toponymie (les affluents sont nommés). La cartographie sur commande avec, comme ici, travail en lien avec un expert apporte aussi son lot de contraintes. L’expert, qui a une vision d’ensemble, aimerait parfois faire figurer beaucoup de données couvrantes, c’est-à-dire figurées par des aplats de couleur. Mais, contrairement aux figurés ponctuels ou linéaires, les figurés zonaux se superposent mal : le recours à des trames comme les hachures est assez limité. Ainsi le relief, qui conserve une importance réelle pour l’Amazone qui prend sa source dans les Andes avant de traverser une plaine alluviale, a-t-il été figuré par un grisé léger, qui ne constitue pas une trame au sens strict et n’altère pas autant la lisibilité que des courbes de niveau.

La bonne représentation des données suppose de les trouver en réfléchissant à leur fiabilité (ici une ONG qui travaille à l’échelle de l’Amazonie a beaucoup aidé ; certaines données intéressantes trouvées par ailleurs mais non sourcées n’ont pas été utilisées afin de garantir le niveau scientifique de la Mappe) ; parfois c’est la consultation directe d’articles scientifiques qui seule peut les fournir. La fiabilité des données reste toujours un plafond de verre indépassable ; mais le fait d’avoir des sources sérieuses, de les citer et de ne pas les mélanger pour une même donnée est un gage de scientificité. Il convient ensuite de hiérarchiser entre les données principales qui doivent absolument figurer et les données secondaires ; durant cette étape de sélection et de simplification, des fusions de données ou de catégories de données sont possibles (des espaces protégés relevant de différents classements peuvent être associés, tout comme des minerais différents). Cartographier, c’est faire des choix. Des « ruses » sont possibles : ainsi le choix de privilégier le volet humain sur la carte principale s’accompagne-t-il du recours à un carton, une petite carte qui permettra de représenter plus de données sans saturer la carte principale.
L’étape de représentation graphique va toujours du général au particulier, des trames les plus couvrantes au figurés ponctuels les plus limités. Cela garantit une lisibilité optimale des superpositions éventuelles. Ces dernières sont traitées pour ce qui est des aplats par des hachures ; encore faut-il bien les choisir afin d’obtenir un résultat agréable à l’œil. Certaines données peuvent aussi changer d’implantation cartographique : un figuré zonal (région minière) pourra couvrir une zone concentrant des symboles ponctuels de même types (mines) ; un simple trait, figuré linéaire, pourra entourer cette même zone pour alléger la carte et en optimiser la lisibilité et le message. À chaque nouvel ajout sur la carte, des révisions des couleurs peuvent s’imposer. La cartographie, même numérique, reste un travail manuel minutieux ; les symboles sont placés un à un. Une carte Mappe, c’est l’équivalent d’une semaine de travail en continu (contre une journée au maximum pour une carte classique), même si cela s’étale sur plusieurs semaines, avec d’autres projets. Quand la carte est achevée, il ne faut pas oublier la relecture par les yeux extérieurs de l’expert (pour corriger) et par des personnes ne connaissant pas le sujet (pour vérifier la clarté) ; tout en faisant la part des choses, c’est essentiel.

L’intervention suivante est celle de Delphine Papin, contributrice d’Hérodote dans la lignée de sa formation à l’Institut Français de Géopolitique de Paris VIII, et qui a travaillé pour Le dessous des cartes. Surtout, elle dirige actuellement le service infographie du journal Le Monde. [5] Elle représente donc une cartographie différente de celle d’Aurélie Boissière. La cartographie journalistique présente notamment une contrainte d’espace (même si la carte occupe de plus en plus de place dans le journal) et de temps accrue. On répond notamment à une actualité très immédiate dans un journal comme Le Monde. Ce journal a toujours publié des cartes, depuis sa création à la Libération ; la volonté de mettre la carte en avant dans le journal se traduit par des moyens financiers importants : au-delà des logiciels coûteux, il n’est que de penser à l’équipe de 14 personnes du service, qui en fait le plus gros service infographie de France pour un journal. C’est un choix politique pour le journal, surtout dans un contexte financier délicat (l’externalisation serait moins coûteuse). La journée du Monde commence à 10h45 pour s’achever à 10h30 le lendemain matin, tout retard étant préjudiciable (une minute, c’est 2 000 exemplaires tirés en moins). En effet Le Monde est un quotidien du soir ; ce qui sort le soir du jour n commence à être discuté en fin de matinée du jour n-1. Les sujets sont décidés par service (le service international est l’un des plus concernés par la cartographie) en fonction des remontées des correspondants. Le service infographie est consulté pour savoir ce qu’il est possible de mettre en carte ; des dépêches très diplomatiques, sans aspect territorial, ne peuvent parfois pas être cartographiées. À midi, la grande conférence de rédaction valide les orientations. Les cartes doivent donc être réalisées en moins de 24 heures. La contrainte de place, surtout pour les cartes occupant une demi-page ou une page entière, ne doit pas non plus être négligée. Le cartographe est en « concurrence » avec le rédacteur (qui doit couper son texte) et le photographe (qui doit réduire ou supprimer ses propres illustrations). Si actuellement tout se passe en général bien, il a fallu conquérir les esprits au journal ; les lecteurs, même s’ils lisent tous différemment la carte (rapide vision d’ensemble ou étude en détail), étaient acquis à la carte grand format avant que la majorité des concepteurs du journal ne le soit.
Un élément qui semble aller de soi est la légende avec un raisonnement. C’est classique dans l’enseignement et dans les formations universitaires ou l’édition de livres mais parmi la presse c’était plutôt innovant. Le but est d’expliquer, de dépasser la logique de la simple flèche montrant un flux (par exemple l’émigration des Érythréens) pour donner du sens (expliquer leur départ, en l’absence de guerre, depuis un pays mal connu du lecteur français). Il faut aussi nuancer et recontextualiser, en montrant que les flux migratoires ne sont pas tous tournés vers l’Europe (Israël était une destination majeure aussi). Le défi est d’autant plus grand pour un pays qui est un angle mort de la presse (faiblesse des données, absence de correspondant sur place, etc.). La cartographie du Monde tranche par ailleurs avec elle des autres grands quotidiens de référence dans le monde. Les grands quotidiens s’observent entre eux (le Guardian, le New York Times, El País, même si les liens sont moins forts dans ce dernier cas) et se respectent mais travaillent de façon différente, avec des conventions ou des habitudes qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, et on le voit à propos de la Syrie, les Anglo-Saxons sont très attachés au quantitatif, avec des cercles proportionnels figurant les data. Le Monde fait le choix de cartes plus qualitatives, estimant qu’on peut cartographier du sentiment comme les représentations en termes de peur qu’ont les chiites d’un territoire sunnite et vice-versa, le sentiment de crainte de l’État israélien par rapport à ses voisins (la Jordanie fait moins peur que d’autres). Pour le New York Times, il est inconcevable de représenter cela faute de statistiques ; pour Le Monde, cela concerne le territoire et cela s’écrit donc cela peut se cartographier. Le Guardian a sa propre vision aussi ; il est bien dans le traitement de données quantitatives et a une construction de légende raisonnée.
Malgré de gros moyens, faire des cartes n’est pas facile. La première carte sur le conflit en Syrie date dans le journal de mars 2011, ce qui est très tardif. Une première raison est qu’alors la Libye occupait le devant de la scène et que Le Monde assurait une veille dessus. Le second problème est la complexité du conflit. Les cartographes ne comprenaient eux-mêmes pas bien ce conflit, vite associé à une grille de lecture en termes de religion (chiites et sunnites) ou de peuples (avec les Kurdes) alors qu’en fait les mouvements dans les rues portaient sur d’autres logiques revendicatives. Les plages de couleur sont faciles à réaliser mais elles peuvent donner une lecture fausse d’un conflit. Il y a une vraie prudence à avoir, surtout pour une publication qui se veut de qualité et qui est citée et recitée comme source. Le conflit en Syrie, au moins au départ, suit une logique politique que les photographes et rédacteurs peuvent bien expliquer et non une logique territoriale. On peut faire plusieurs cartes pour un tel conflit ; les sources permettent de choisir les plus appropriées. La consultation d’universitaires, de personnes présentes sur place et la localisation des violences données par les dépêches AFP a ainsi permis de construire une carte à l’échelle locale de la ville d’Alep, donnant au conflit syrien une grille de lecture socio-économique (les quartiers riches sont moins touchés) et politique (les quartiers réaménagés récemment, où les gens échangeaient beaucoup à propos de leur futur, se sont plus soulevés). Une telle carte a permis de renverser la hiérarchie : ce n’est plus la carte qui illustre le texte mais c’est la carte qui oriente le texte dans un nouveau sens. Dans ce cas extrême, la carte a même pu modifier, par la lecture globale qu’elle propose grâce au changement d’échelle, la perception de témoins présents en Syrie, comme Florence Aubenas. Les témoins oculaires restent cependant très précieux ; Jean-Philippe Rémy après un séjour de 2 mois en Syrie (il devait n’y rester que quelques jours comme envoyé spécial mais son exfiltration a été compliquée), a livré des informations originales, des anecdotes (sur la présence ou non d’électricité, sur la largeur suffisante ou non des rues pour le passage des chars), permettant dès le lendemain de son retour de produire une carte originale. En croisant ses informations avec Google Earth, c’est un point d’achoppement, un verrou, un nœud au cœur de la bataille de Damas qui a pu être placé.

Parfois la carte au sens strict n’est pas la représentation la plus adaptée ; un schéma, y compris appuyé sur les échelles (à la manière d’Yves Lacoste), peut être plus efficace. On ne le sait pas au début mais on s’en rend compte progressivement ; il y a un droit à l’échec. Cependant là encore la collecte des données, en croisant les sources (avoir un arabophone est ainsi essentiel), constitue une grosse partie du travail d’infographie. Une fois les données acquises, intervient la phase de réalisation graphique. Elle se fait d’abord à la main, avant d’être présentée pour validation au service international, puis d’être réalisée avec un logiciel de dessin vectoriel voire un logiciel 3D pour architectes pour certaines illustrations requérant de la profondeur. Parfois le résultat est trop complexe donc il faut re-synthétiser le travail (en supprimant par exemple une quatrième échelle) ; une simple modification d’angle de vue peut obliger à travail avec des décalages difficiles à mesurer. Les contraintes sont multiples et doivent être résolues en un temps limité ; dix jours à l’avance, on ne sait pas ce qu’on va traiter donc on ne peut pas s’y préparer. Quand les sources manquent (par exemple les nombreux réfugiés et déplacés du conflit syrien rendent les statistiques inopérantes) ou sont trop anciennes (cartographier les religions en Birmanie sur la base du recensement de 1954 n’a aucun sens), mieux vaut ne pas produire d’illustration. Quant au choix des couleurs, cela reste une question pour laquelle il n’y a que des mauvaises réponses. La couleur fait partie de la signature du cartographe et reste subjective, soumise à son humeur, même si certaines conventions (l’agriculture en vert) perdurent (en revanche les mers sont souvent figurées en blanc et plus uniquement en bleu). Il est dur de trancher parfois : le rouge est associé au danger mais qui de Bachar-Al-Assad ou de l’État islamique est le plus grand danger ?
Une table ronde clôt la matinée autour d’Alain Miossec (recteur honoraire et géographe spécialiste du littoral), Florence Smits (Inspectrice Générale), Christophe Léon (Responsable de la commission du numérique de l’APHG et Trésorier de la régionale d’Aquitaine), Yves Veyret (Professeur Émérite à Nanterre, spécialiste des risques et du développement durable) et Dario Ingiusto, cartographe formé à Bologne et qui travaille pour Carto, Hachette ou Le Monde diplomatique. L’engagement cartographique, illustré par Philippe Rekacewicz et sa dénonciation par exemple des morts de la Méditerranée, donne lieu à un débat sur l’objectivité cartographique, sachant que choisir de faire une carte sur un conflit plutôt qu’un autre est déjà une forme d’engagement. L’engagement peut varier selon le lectorat visé mais il faut assumer ses choix. L’enseignant quant à lui va éveiller l’esprit critique de ses élèves et leur montrer combien la carte comprend un message et est en fait tout aussi subjective qu’une caricature. La carte est une source à analyser comme tout texte en histoire : la dramatisation en matière environnementale est souvent excessive par exemple et les cartes de synthèse sur le développement durable oublient largement les aspects sociaux. Les cartes sont des sources d’information permettant de croiser les approches et les échelles, les démarches analytique et synthétique ; elles sont désormais au cœur des programmes. La multiplication des cartes, notamment idéologiques, pose la question de leur réception. Il faut voir ce qui n’est pas représenté, réfléchir aux couleurs utilisées (le monde occidental en bleu, l’URSS en rouge dans les manuels scolaires), s’attarder sur les détails que l’élève ne note pas (une frontière en pointillés entre Israël et la Cisjordanie). Une carte comme celle de l’Australie avec le sud en haut a le mérite de poser la question de nos représentations, tout comme les différentes projections pour varier de la Mercator classique : incidemment une carte centrée sur les États-Unis montre aux élèves combien le détroit de Béring est étroit. Déconstruire les cartes et en multiplier le recours, notamment en histoire, permet d’éviter le formatage des élèves, en introduisant une complexité croissante.
Une deuxième grande orientation est la question du numérique, avec les TICE qui constituent une aide pédagogique réelle tout en induisant un formatage particulier. Recourir à Google Earth peut se faire dès la 6ème, avec une séance de deux heures, à condition de prévoir une solution de secours (avec des captures d’écran) en cas d’incident. Le numérique est de plus en plus valorisé dans les programmes mais aussi les concours de recrutement même si les questions d’équipement sont un facteur limitant. Le numérique ne doit pas se substituer au concret ; il lui est complémentaire. La cartographie est un langage à maîtriser pour les épreuves de croquis qui permettent au maximum d’élèves d’acquérir le baccalauréat (le système de la liste de croquis à connaître n’empêche pas d’étaler les notes) ; la carte peut même se substituer au texte (un bon croquis vaut mieux qu’un long discours) et la démarche associée développe des capacités de rigueur et de hiérarchisation. Les journalistes comme les chercheurs partent d’abord d’une représentation à la main pour ne pas être focalisés sur l’outil technique. Le numérique va permettre, avec un système de couche, des superpositions bien plus réussies ensuite. Les cartes produites fascinent et constituent un outil stratégique, même pour les rectorats ou le Ministère. La carte est un outil de diagnostic mais également de projection, à critiquer toutefois.
L’après-midi est dédiée à des expériences concrètes, de terrain. Jackie Pouzin intervient pour présenter Edugéo, la déclinaison éducative du Géoportail (qui a une meilleure résolution que Google Earth, qui stocke cependant une partie en local), et au titre de son expérience avec les outils SIG (Systèmes d’Informations Géographiques) en lycée. Edugéo est accessible via la messagerie académique par Eduthèque. On peut y afficher plusieurs couches, avec de la transparence, par exemple pour comparer la carte de Cassini et la carte IGN actuelle et faire un peu de géohistoire. Une zone spécifique par académie a été identifiée par l’inspection pour se prêter à un exercice de croquis avec les élèves. Pour ces études de cas, l’ensemble des données sources est accessible, sans problèmes de droit, afin de parer à l’aléa de la connexion. Les outils numériques permettent de modéliser l’espace et donc, en moins d’une heure, de faire comprendre aux élèves certaines catastrophes comme les inondations de Xynthia, en insistant sur leur origine anthropique, dans un cours sur le risque et le développement durable.

Nathalie Rodallec expose ensuite une application sortie en mai 2015 avec le soutien de Canopé et dont elle est co-auteur, Géo Croquis Bac [6] Forte d’une expérience variée (en ZEP notamment), elle souligne que la genèse du projet part du constat de la difficulté à travailler le croquis, notamment en lycée où la complexité des croquis rend le travail chronophage. L’application offre plus qu’une carte interactive ; elle reprend la démarche complète de la conception d’un croquis (analyse du sujet, sélection des informations, conception du plan, etc.). Il est important que les élèves l’acquièrent durant la Terminale, dernière année où tous suivent des cours de géographie. L’application devrait être étendue mais comprend déjà les 7 croquis des séries générales. Elle permet une correction automatique des réponses des élèves qui peuvent travailler et se réentraîner à l’infini avec leur smartphone mais zoomer sur la carte, ce que ne permet pas un manuel papier. L’application s’utilise aussi en classe, comme support de discussion autour de la problématique, de l’organisation du plan ou des choix de représentation. Dans tous les cas, l’enseignant reste maître de l’outil et doit s’en emparer ; l’élève ne va pas travailler de lui-même en totale autonomie.


Le retour de terrain suivant part du constat que les élèves ont désormais du mal à enregistrer les cartes, même sur le monde ou l’Europe (Françoise Martin, Sonia Laloyaux et Vincent Schweitzer) ; ce ne sont pas des documents patrimoniaux comme en histoire et la meilleure preuve que la carte ne fait pas sens est qu’il y a toujours des élèves qui collent les cartes à l’envers en collège ou colorient la Russie comme une mer (face à la saturation d’images dans leur monde, ils ne voient qu’un ensemble de traits). Il faut donc dès la 6ème démystifier la carte, en variant les projections et les échelles et en travaillant avec les élèves sur la carte comme source, avec une progressivité et en prenant en compte les représentations des élèves. Revenir aux fondamentaux de localisation, pour que les élèves voient plus que quatre fois par an une carte du monde en collège, est nécessaire. C’est la continuité pédagogique chapitre après chapitre qui fait l’efficacité. Les bons documents doivent être choisis ; souvent, sur l’Europe notamment, quel que soit le manuel, les éditeurs font les mêmes choix cartographiques mais dans le détail quelques cartes sont mieux faites que d’autres (les manuels scolaires comprennent des erreurs et des manques : oubli de l’échelle, etc.).
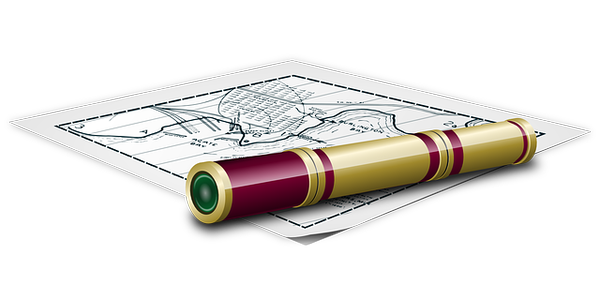
Chantal Le Guillou (Présidente de la Régionale APHG Poitou-Charentes) termine la journée en revenant sur le croquis en lien avec la géographie de la France et l’aménagement du territoire en 1ère. Elle souligne combien la cartographie manuelle reste formatrice, en s’appuyant sur son parcours (enseignement de la cartographie à l’Université, avant de revenir en lycée). Les élèves doivent apprendre ce qu’est le fond de carte. La technique ne fait pas ; la simplicité reste de mise. En hiérarchisant bien les outils (crayons de couleurs pour l’arrière-plan, feutres pour le premier plan), même avec six couleurs, on peut faire de beaux croquis. On forme des adultes responsables et non des géographes mais encore faut-il avoir un fond de carte adéquat. Souvent certains traits manquent tandis que d’autres sont inutiles. Les élèves doivent parvenir à s’approprier une image mentale de leur pays. Ils ne connaissent pas les régions ; comment parler mondialisation quand les élèves ne savent pas placer Singapour et Malacca sur une carte ? La localisation n’est pas un luxe et le bachotage doit être dépassé. Le coloriage est important mais le fond prime ; certains élèves n’osent mettre du blanc pour corriger une grosse erreur car ils privilégient le côté esthétique. Le croquis de synthèse doit bien être l’aboutissement des apprentissages. Sa notation se fait selon des critères explicites et explicités même si c’est un ensemble qui est évalué.
Après quelques échanges avec une collègue venue de Martinique avec ses élèves, la clôture de cette journée enrichissante est assurée par Samuel Depraz et Yvette Veyret.

© Thomas Merle - mars 2016.
© Les services de la Rédaction de l’APHG et d’Historiens & Géographes - Tous droits réservés. 21/04/2016.















