Par Noémie Lemennais et Sihem Bella [1].
Café du 7 décembre 2020 : Hélène Dumas, Sans Ciel ni Terre. Paroles orphelines du génocide des Tutsi (1994-2006)

Hélène Dumas est chercheuse au CNRS à l’histoire du temps présent, elle a réalisé une thèse sur le génocide des Tutsi. Cette thèse a donné lieu à un ouvrage très remarqué en 2014. Le livre présenté ce soir est un beau livre : Sans Ciel ni Terre. Paroles orphelines du génocide des Tutsi. L’ouvrage est divisé en trois parties mais sans conclusion parce que Hélène Dumas n’a pas jugé opportun de reprendre la parole après ces « paroles orphelines ».
Anthony Guyon (APHG Nice et docteur en histoire) et Sihem Bella (APHG Nord-Pas-de-Calais, doctorante à l’université de Lille) conduisent l’entretien pour l’APHG.
Anthony Guyon : Vous dites que le livre se fait à l’« échelle de la colline », pourquoi avoir fait ce choix ?
Hélène Dumas : C’est un génocide qui a été particulièrement efficace : environ 1 million de personnes disparues en moins de 3 mois et la majorité des victimes en avril. Il s’agit donc d’un génocide d’une effroyable efficacité. Comment est-il possible d’assassiner autant de personnes dans un laps de temps aussi court ? Il y a un premier début de réponse dans l’étau meurtrier que forme l’état rwandais parce qu’il ne faut pas oublier que tout génocide est un crime d’Etat. Ce n’est pas un Etat failli, c’est un état très structuré avec une administration qui va jusque dans les collines, avec une armée puissante et entraînée en partie par l’appui par la politique française entre 1990 et 1994. Ainsi, ce sont donc une armée, une administration, des médias, des services de transport en commun qui participent à ce génocide. Cet état va investir tous ces moyens dans l’extermination des Tutsi à partir du 7 avril 1994. Le deuxième élément de réponse réside dans le retournement des solidarités anciennes sur les collines mêmes. Cet étau a réduit leur chance de survie à l’extrême.
AG : Il existe un négationnisme du génocide, certains prétextant qu’il est difficile de distinguer un massacre d’un génocide. Pouvez-vous présenter le climat social en mars 1994 ?
HD : Un génocide n’est jamais un accident. Il y a une histoire longue du racisme anti-Tutsi qui se retrouve intégrée dans le déclenchement de la guerre avec le front anti patriotique rwandais (FPR) en octobre 1990. Cet imaginaire va être porté à son paroxysme par le gouvernement qui va voir dans tous les Tutsi des ennemis. À partir de 1992, un certain nombre de structures se mettent en place : programme d’auto défense civile composé de vaillants Hutu acquis à la cause républicaine qui sont enrôlés ou qui s’enrôlent dans des opérations de guerre contre le FPR. Cette confusion entre le civil et le militaire, tant du point de vue des civils et des auteurs, est importante pour comprendre le génocide. Le fait de tuer répond à une crainte : si je ne tue pas l’autre, c’est l’autre qui va me tuer.
Sihem Bella : Quelle est historiographie sur le génocide des Tutsi dans le reste du monde ?
HD : Très peu de personnes travaillent sur l’histoire du génocide, y compris au Rwanda, et ce pour des raisons simples. Le pays s’est reconstruit sur le business et très peu sur le développement des sciences sociales. C’est ainsi qu’il manque une génération d’historiens. Ailleurs dans le monde, la situation est assez compliquée en raison de la question du négationnisme. On peut prendre l’exemple, en 2018, dans le monde anglo-saxon, le livre, Rwanda. L’éloge du sang, de Judi Rever, journaliste canadienne, a eu les honneurs alors qu’il est négationniste.
De plus, il y a des difficultés pour réaliser cette histoire, notamment le fait d’avoir des débats d’interprétation lorsqu’en face on est confronté à des discours de négation ou de dénaturation. Il y a bien eu dans le champ historiographique américain des années 1990 des travaux, mais depuis plus rien. Il y a quelques historiens en Belgique, France, Rwanda, mais ils sont assez peu nombreux.
SB : Beaucoup de polémiques surviennent en France à cause des thèses négationnistes et à cause de l’implication de la France. Qu’en est-il de l’accès aux sources ?
HD : Tout dépend de ce sur quoi on travaille : l’implication française dans le génocide ou le génocide en lui-même. Quand on travaille sur l’histoire du génocide, les sources sont au Rwanda, il faut arpenter les paysages, mais on dispose d’une relative liberté. Il y a plus de problèmes pour accéder aux archives sur la politique française dans les archives française. Il faudra sans doute attendre le rapport de la commission Duclert le 5 avril prochain pour savoir si ce fameux rapport sera une histoire de clôture ou un point de départ sur l’ouverture des archives françaises sur le Rwanda. C’est important que ce rapport soit une ouverture plutôt qu’une fermeture.
SB : Dans l’ouvrage vous centrez votre intérêt sur un certain type d’acteurs : les enfants. Il s’agit de retranscrire les paroles de 500 orphelins à travers 12 000 feuillets, dans une perspective testimoniale et de catharsis. Quel intérêt pour l’historiographie du génocide ?
HD : Je suis tombée par hasard sur ce corpus. Depuis 2015 le projet de recherche est axé sur l’histoire au long cours sur les victimes du génocide. A l’origine cela devait être centré sur les femmes violées pendant le génocide (beaucoup vivent avec le SIDA). La découverte de ces cahiers a bouleversé le calendrier de travail. Ces cahiers ont été traduits avec deux personnes qui sont elles-mêmes rescapées du génocide. La traduction peut paraître un peu étrange parce qu’il s’agit d’une traduction des expressions mot à mot qui disent les expériences. La première chose qu’il a fallu faire, c’est faire des phrases parce que les récits ont été jetés sous la forme d’une longue phrase sans arrêt. Mais ces témoignages permettent de voir le génocide au microscope : avant, pendant, après décrit à l’échelle individuelle (ce sont des textes écrits à la première personne) et à l’échelle des foyers. La langue fait revivre les scènes de massacre aux yeux des lecteurs avec une minutie descriptive : tueurs, gestuelles, mots très présents. Il est très important de montrer qu’à travers ces textes, les victimes avaient entretenu de nombreuses interactions avec le tueur. Ce sont de véritables sources historiques apportant une très grande richesse sur le plan heuristique.
AG : L’introduction est intéressante sur les précautions, quels sont les travaux qui vous ont inspirée, notamment pour le traitement des sources d’enfants ?
HD : L’histoire des enfants en tant que telle est très intéressante sans passer par le filtre d’un discours d’adulte. Ce sont des sources tout autant légitimes d’un point de vue historique. Cet ouvrage est donc également l’histoire d’une rencontre avec ce corpus si particulier mais si enrichissant.
SB : Sur cette rencontre, vous parlez de votre crainte d’avoir affaire à des récits de résilience. Que voulez-vous dire ?
HD : Depuis quelques années au Rwanda, lors des commémorations, on fait intervenir des personnes qui étaient très jeunes en 1994 pour raconter l’histoire de la reconstruction du pays assimilée à la reconstruction individuelle. Je craignais donc que ces récits soient également des discours de cette sorte : faire écrire des jeunes gens dans ce but-là, afin de raconter une histoire de la résilience. Mais cela n’a pas été le cas au contraire. Un ou deux récits de résilience auraient fait du bien pendant la traduction parce que ce fut également un exercice très éprouvant psychiquement. On se demandait quand le FPR allait arriver pour que cela cesse. Il y a vraiment des récits de désespoir absolu, et pour beaucoup le génocide ne s’est pas terminé le 4 juillet 1994.
SB : Vous avez fait le choix de ne pas conclure, de vous effacer devant les sources, et donc de réaliser une histoire de l’enfance par l’enfance. Quel rôle vous donnez-vous ? Quel rôle pour l’historien au-delà de la transmission ?
HD : C’est déjà un beau rôle que de transmettre ce type de source. Les jeunes scripteurs veulent que leurs discours soient connus de tous. Ce livre s’est inscrit dans un projet éditorial particulier : la collection « à la source » dirigée par Clémentine Vidal-Naquet. L’objectif est de laisser toute sa place à la source et à l’archive, et donc ici de laisser toute la place à la parole des orphelins. Il était hors de question de parler à leur place, ou jouer le surplomb. C’est aussi une source qui force à l’humilité. L’historien ne saurait décrire ce qu’ils ont vécu et comment ils l’ont décrit. Il faut savoir s’effacer : pour des questions de transmission, de questions morales et éthiques.
AG : Comment fabrique-t-on cette haine des Tutsi à l’école ?
HD : Dans les cahiers, il y a une approche concrète de l’histoire enseignée à l’école et cette assignation identitaire à laquelle les élèves ne comprenaient pas avant d’aller à l’école (les parents n’en ont pas parlé), comme ils n’ont pas parlé des persécutions des années 1960. C’est quand les enfants sont enjoints de dire qui ils sont par les instituteurs que le silence familial est levé. Il est important de restituer la manière dont cette identité leur a été assignée.
AG : Comment les enfants vivent ces premiers jours après le 7 avril ?
HD : Certains éléments apparaissent de façon récurrente : le changement de physionomie des adultes ; la crainte qui les envahit, surtout quand ils ont vu leur père (perçu comme invincible) prendre peur. On observe chez les adultes des stratégies de survie qui vont s’avérer fatales : le souvenir des persécutions antérieures va les guider vers les mauvaises cachettes qui vont devenir des pièges, comme notamment les lieux de culte. Lors des précédents massacres dans les années 60, les tueurs n’étaient pas entrés dans les églises. C’est également une société pétrie de croyances religieuses, c’était donc un moyen de se placer sous la protection de Dieu. Cette maigre stratégie de survie va se révéler fatale.
SB : Quelle est la valeur de ce corpus en comparaison avec des témoignages oraux de survivants ? Malgré un contexte d’écriture particulier (2006, 12 ans après), qu’est-ce qui fait leur valeur par rapport à des témoignages oraux ?
HD : L’une des grandes qualités est le récit écrit à la première personne (atelier d’écriture) et un face à face individuel entre le scripteur et sa propre écriture et mémoire, qui serait différente si elle était guidée par les questions d’un interlocuteur. De plus, en 2006, les tensions sont encore fortes dans les collines, un grand nombre de rescapés sont assassinés. Ils ont écrit en avril en pleine période de commémoration. Personnellement, pour des questions déontologiques je refuse d’interroger des rescapés en pleine commémoration. Là, le cadre d’écriture est précis, c’est un cadre de confiance composé de rescapés susceptibles de les comprendre.
AG : La traduction a-t-elle aidé dans l’abord du texte en temps qu’historienne ?
HD : Bonne question. Je ne sais pas. Prenons l’exemple du texte « Théâtre de la cruauté ». On voulait intervenir le moins possible, mais on s’interrogeait également si on donnait à lire ces scènes. Elles sont données à lire au Rwanda parce qu’il y a une familiarité avec ce type de récit. Or, cette familiarité est absente en France. Par ailleurs, se pose la question de la méthode de la transmission de ces textes. Est-ce que ces scènes sont visibles, audibles ? Il ne faut pas non plus les censurer, ni euphémiser, ni cacher leurs propos.
AG : Aujourd’hui, comment décrire le contact, les relations entre victimes et anciens bourreaux ?
HD : Dès que c’est possible, j’envisage un retour au Rwanda pour le savoir et rechercher les personnes du livre afin de connaître leur situation. Mais en 2006, la plupart ont demandé à ce que leur récit soit publié mais à ne pas apparaître sous leur identité parce qu’ils ont peur du voisinage et d’être assassinés. Aujourd’hui, les procès sont terminés au Rwanda. Mais il est impossible de savoir la situation présente, c’est la prochaine étape de ce projet de recherche.
Il y a également la volonté de mettre un exergue sur la poursuite de l’hostilité du voisinage : « Nous leur pardonnerons jamais le mal qu’on leur a fait ». Il est possible que ce voisinage aurait préféré voir mourir ces enfants avec leurs parents. C’est une véritable hostilité continue que l’on peine à imaginer. Le génocide finit en juillet 1994 mais le Rwanda est encore en guerre jusqu’en 2002. Les personnes évoluent dans un contexte de violence long dans la durée. Les rescapés vivent avec le génocide chevillé à leur existence matérielle accompagnée de souffrance psychique.
Questions de l’auditoire
Comment le racisme anti-Tutsi était vécu par les familles avant le génocide ?
Quand on est Tutsi, tout l’horizon social est assombri. Les Tutsi avaient peu de chance d’avoir un niveau d’éducation supérieure, au-delà de l’école primaire. Il y avait également une stratégie d’accommodement par les parents pour tenter de vivre sous ce régime de racisme institutionnalisé.
Comment les structures familiales ont-elles survécu ? Les rescapés ont-ils retrouvé leur famille ?
Les enfants vont se regrouper en famille d’enfants avec à leur tête un plus âgé, mais sans lien de parenté. Il existe des associations d’élèves rescapés du génocide qui prennent en charge les élèves du secondaire pendant les vacances scolaires pour éviter qu’ils meurent de faim parce qu’ils n’ont pas les moyens de cultiver les terres. Il y a toute une forme de parenté alternative qui se développe.
Dans le Rwanda d’aujourd’hui, des solidarités de survivants se constituent-elles pour peser sur les politiques mémorielles ? De même dans la vie politique ?
Il existe des groupes de solidarité, beaucoup d’associations, groupes de parole de femmes qui sont autant de reconstitutions familiales. Il y a également beaucoup d’initiatives comme l’association IBUKA : association la plus importante qui agit sur les espaces intercommunautaires, commémorations locales. Dans le champ politique, on n’observe pas de lobby des rescapés.
Y’a-t-il une histoire scolaire du génocide ? Existe-t-il une négation dans l’enseignement et la mémoire ?
Il y a des contradictions politiques majeures depuis 1994. L’une des premières décisions du FPR est de suspendre les cours d’histoire dans le secondaire. Il est donc difficile d’apporter une réponse claire : est-ce que le génocide est enseigné en tant que tel ? Le premier manuel scolaire date de 2017 mais il est difficile de savoir comment c’est enseigné concrètement. En parallèle il y a des commémorations nationales puisqu’il ne faut pas oublier que 50 % de la population n’a pas connu le génocide. Depuis 2008 la constitution a été changée pour pouvoir parler du génocide des Tutsi. Les rescapés savent qu’ils ont été tués parce qu’ils savaient qu’ils étaient Tutsi, mais aujourd’hui beaucoup parlent au passé de leur critère identitaire : j’étais Hutu, j’étais Tutsi
Quelles ont été les stratégies mises en œuvre pour protéger les enfants Tutsi ?
La première chose était d’extraire ces enfants du maillage du voisinage parce que c’est cela qui permet l’identification, la traque. Il est difficile de faire cela et de cacher des gens pendant 3 mois. Toutefois, au sein même des familles des logiques sont contradictoires : des parents vont sauver des enfants, tandis que leurs propres enfants vont participer aux massacres. De plus, on évolue dans un univers où les maisons sont assez ouvertes et modestes. Il fallait aussi les extraire de leur généalogie Tutsi en mentant dessus et sur leur lieu de naissance.
Compte-rendu réalisé par Noémie Lemennais
***
Café du 10 décembre 2020 : Stéphane Beaud, La France des Belhoumi, Paris, La Découverte, 2018.
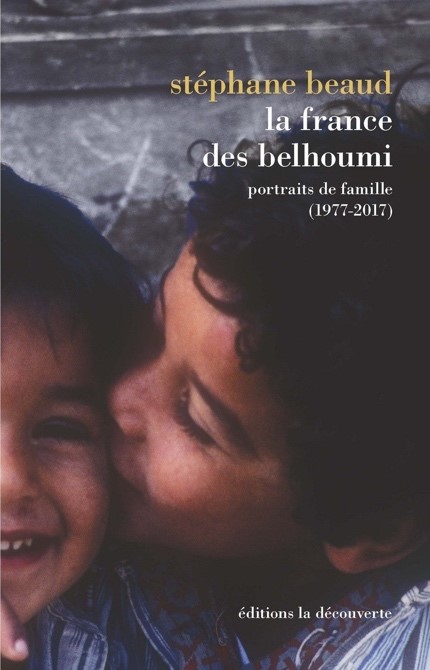
Stéphane Beaud est sociologue, Professeur de sciences politiques à Sciences Po Lille et spécialisé dans l’anthropologie politique, l’étude des classes laborieuses avec en 2005 Retour sur la condition ouvrière : enquête aux usines Peugeot de Sochaux Montbéliard, 2005 (travail tiré de sa thèse) et plus récemment Affreux, Riches et Méchants ? Un autre regard sur les Bleus avec Philippe Guimard (2014)
Dans ce café, il présente La France des Belhoumi, portraits de famille, 1977-2017, première édition en 2018, une seconde en 2020 avec une préface de Samira Belhoumi. C’est un ouvrage ayant fait l’objet de nombreuses critiques élogieuses, notamment sur la complexité des regards, des identités, des sentiments d’appartenance et des parcours de vie qui émergent à sa lecture. L’appréciation, souvent énoncée, d’un ouvrage de sociologie se découvrant « comme un roman » est récurrente parmi les recensions. Une famille que l’on suit sur plusieurs générations, depuis l’arrivée de Madame Belhoumi rejoignant son mari travailleur sur le sol français à nos jours.
Ivan Burel (membre de l’APHG- Nord-Pas-de-Calais et doctorant à l’Université de Lille) et Sihem Bella (APHG Nord-Pas-de-Calais, doctorante à l’université de Lille) conduisent l’entretien.
Question 1 : La lecture de cette enquête familiale poussée, de cette fresque sur près d’un demi-siècle pourrait rappeler diverses sagas littéraires, certaines ayant pour visée d’apporter un regard réaliste sur les conditions de vie d’une certaine catégorie de population. Le naturalisme de Zola et de ses Rougon-Macquart, les Buddenbrooks de Thomas Mann, les Forsyte ou les Hessling « herbarium de l’homme allemand du Kaiserreich » pour Heinrich Mann. Certaines de ces œuvres sont en réalité des descriptions de personnages réels, avec des noms d’emprunt. N’avez-vous pas également écrit un roman familial, une fresque de non-fiction, réaliste ?
Stéphane Beaud : Je réalise un travail de sociologue, je suis donc très attentif à ces relations entre liens passé et présent. La sociologie et l’histoire sont des disciplines-sœurs. Ce livre s’est appuyé sur une enquête particulière : une histoire familiale racontée oralement par les 8 membres de la fratrie, les enfants. Une des clés d’entrée repose sur le principe d’anonymat pour les protéger et il faut un intérêt. Au départ de cette enquête c’est le contact avec les trois sœurs nées en 70, 73 et 84 qui ont bien voulu que je raconte l’histoire familiale. Il s’agissait également de donner une image plus riche et moins caricaturale. Il y a dans ce projet de livre la volonté de raconter une histoire familiale de ce type tout en luttant contre les préjugés. La forme de fresque historique est une commande de leur part. L’enquête a duré 4 ans, ce fut un travail de fourmi.
Question 2 : Quel est le rôle de l’école dans le parcours des Belhoumi ? Les parents les ont encouragés à travailler avec le stylo comme vous l’écrivez dans votre livre.
SB : Ce n’est pas une histoire d’émigrés mais une histoire de milieu populaire. Le père les encourageait à travailler avec le stylo tandis que lui travaillait avec ses mains, c’était un rêve, une aspiration. L’école c’est la voie de la réussite parce que la famille n’a pas de réseau. Le père qui n’a pas fait d’école est celui qui encourage le plus. La mère, qui a été jusqu’en 4e, est l’écrivain public des autres femmes du quartier qui sont analphabètes en français.
C’est ainsi que le système scolaire dans ces vies a une grande place. Les Belhoumi ne sont pas dans une banlieue de Paris, ils sont dans une banlieue du centre de la France, dans une ville communiste. Dans ces années 70-80, l’école c’est l’aide matérielle mais c’est aussi un regard bienveillant qui élève l’enfant. Pour certains enfants, le français a été une langue de conquête : il y a des enseignants, une bibliothèque municipale qui vont les porter. Samira a passé son enfance à lire et aller à la bibliothèque et rencontrer des enseignants qui lui ont donné le goût de la lecture. Elle a eu son bac ES avec mention, elle a eu le concours infirmière. Les parents voulaient un métier rapide, de femmes et sans université. Les Belhoumi-enfants éduquent leurs propres enfants dans le privé comme les classes moyennes supérieures.
Question 3 : Quels sont les liens entre la sociologie et la littérature à travers cet ouvrage ?
SB : Un des objectifs était de rendre l’écriture ethnographique accessible avec un style travaillé tout en respectant les concepts. Le style est venu naturellement. Le sociologue doit travailler les choses le plus simplement possible. La conclusion est plus théorique en essayant de dégager les apports de cette histoire. Il fallait éviter une écriture jargonnante et en faire une au plus près des individus. Il est même possible de faire une comparaison avec les travaux de la microstoria, une même manière de faire et d’être.
Question 4 : Vous évoquez l’obtention de la demande de nationalité de Samira et la réaction réprobatrice du père, lui reprochant de s’éloigner de l’Algérie, et ce en dépit de son respect avec la terre d’accueil française qu’il manifeste. Samira cependant affirme être des deux rives, ne pas pour autant cesser d’être algérienne. Peut-on à travers cet exemple voir une transition représentatrice d’un passage du « Gastarbeiter » à un citoyen français d’ascendance étrangère ? Y’a-t-il une différence avec l’exemple allemand où la communauté turque descendant de ces Gastarbeiter reste bien davantage structurée et liée à l’Etat turc ?
SB : Le sociologue majeur Abdelkmalek Sayad, algérien kabyle, instituteur, né en 1933, rencontre Bourdieu de 1958 à 1960, et a répondu à la question. Il existe un paradoxe de l’immigration. Les immigrés, comme M. Belhoumi, ont tous l’idée de retour. Ils viennent en France pour améliorer leur situation économique. C’est Mme Belhoumi qui fait pression pour venir, elle impose le regroupement familial. Cela illustre le fait que les femmes jouent un rôle, ce ne sont pas des agents passifs. Elles ont une vraie agency.
Cependant, il va y avoir une triple illusion : 1) celle du retour des immigrés en Algérie 2) celle de l’Etat algérien pour récupérer cette main d’œuvre qualifiée 3) celle de la France de renvoyer des Algériens en Algérie (500 000). Tout le monde pense que c’est une immigration provisoire qui va durer. Pour l’historien algérien Mohammed Harbi c’est la marche de 1983 et l’arrivée de ces militants beurs qui vont enterrer ces espoirs. Les enfants sont pleinement français et se mobilisent politiquement.
Question 5 : Que dire de l’empreinte de la guerre d’Algérie sur la famille Belhoumi ?
SB : Il n’y a pas d’imprégnation permanente de l’histoire coloniale dans la famille comme le montre l’enquête. Cela vaut pour la génération des parents prolétaires, comme le père qui n’a cessé de répéter : « Vous êtes en France, on se projette dans l’avenir, on ne retourne pas dans le passé ». Il avait 18-20 ans au moment de la guerre d’Algérie. Lorsqu’il a 18 ans, il s’engage dans l’armée française et part faire son service militaire à Strasbourg. Il revient en 1962 après l’Indépendance et s’engage 4 ans après dans l’armée algérienne. C’est un témoignage illustrant le fait que tout le monde n’est pas politisé : pendant la guerre d’indépendance, il ne cherchait qu’à survivre, il était loin du FLN. Il n’est pas dans la mémoire d’une transmission du FLN et du militantisme. Les enfants ne savaient pas ce qu’il avait fait pendant la guerre. J’ai dû réaliser un questionnaire pour que Samira fasse l’entretien avec son père afin de combler les trous. En termes de mémoire familiale, personne n’a su dire quand le père était arrivé en France. La deuxième génération ne s’intéressait pas à cette histoire, il y avait assez de soucis. C’est plutôt la 3e génération.
Question 5 : Au-delà de la mémoire de la guerre et de la colonisation, qu’en est-il du rapport de la famille à la politique générale et y compris en France ?
SB : Le résultat de cette enquête est semblable aux milieux populaires. Les parents votent pour l’Algérie, ils sont légitimistes, ils vont au consulat pour voter, mais sans s’intéresser vraiment à la politique. Ils jettent un œil à la politique française. Dans la famille, ce sont les enfants qui vont politiser les parents et qui vont se politiser par les réseaux lycéens et amicaux. La sœur aînée est passée au travers de cette politisation par ses obligations à la maison. La deuxième fille est considérée comme la tête politique de la famille : elle a cherché toutes les informations pour échapper au « cloître ». Il lui arrivait d’aller au catéchisme avec des copines, l’athlétisme, les fêtes de l’Humanité dans cette ville communiste. Elle s’est politisée à gauche, avec la lutte pour les Palestiniens et contre l’apartheid, et le combat social en général. C’est elle qui va transmettre cette conquête politique à ses frères et sœurs : à chaque élection municipale, présidentielle, elle appelle chacun de ses frères et sœurs pour être sûrs qu’ils sont allés voter. Le rapport à la politique est très lié à la politisation : les filles sont politisées, mais les garçons non, ils votent comme leur sœur.
Question 6 : A la lecture du parcours scolaire des enfants Belhoumi, une différence entre les filles et garçons se fait sentir. Le parcours des garçons est en effet plus instable, bien qu’ils arrivent en définitive à trouver tous un emploi. Comment expliquer cette plus grande réussite des filles, qui rejoint les chiffres : 44% jeunes garçons d’origine algérienne accusent de difficultés scolaires en 6e contre 30% des filles ? Une question de socialisation où les jeunes garçons seraient davantage entrainés dans les fréquentations de la « cité » ?
SB : Nous disposons d’un outil très pratique, c’est le panel de la DEPP avec 10 000 élèves suivis de la 6e à la terminale. Concernant le panel de 1995 : 10 000 élèves suivis sur 6 ans : pour la première fois l’origine nationale est prise en compte (nationalité et lieu de naissance des parents). A l’entrée en 6e, 70 % des filles maghrébines n’ont pas redoublé, contre 53 % des garçons. Cet écart va s’accentuer au collège au détriment des garçons. L’enquête de terrain vient confirmer ces données. Comment expliquer cela ?
Il faut distinguer école primaire et collège. Les garçons des Belhoumi, n’ont pas de mauvais résultats : les aînés font la scolarité des cadets chez les enfants. Les sœurs aînées diplômées vont servir de cadre. La sœur aînée va choisir pour Mounir allemand et latin pour la 6e, mais 6 ans plus tard il échoue à son BEP. Il n’y a pas de mystère : au collège, les garçons ont une latitude d’action (ils peuvent sortir, bouger, ils sont moins surveillés), et à partir de la 4e et 3e, ils sont pris dans la sociabilité de quartier allant dehors et travaillant de moins en moins. Les effets de groupe sont très importants.
Question 7 : L’idée de consacrer un livre aux Belhoumi tient à une rencontre, celle de Samira Belhoumi et de 2 de ses deux sœurs à la sortie d’une conférence, où elles disent se reconnaître dans les conclusions que vous tirez de l’intégration d’une famille algérienne en France. On a fait un parallèle avec l’ouvrage d’Oscar Lewis Les enfants de Sanchez, où le sociologue s’entretient avec une famille mexicaine des milieux populaires à Mexico. De même, jugez-vous que votre ouvrage serait une déclinaison, du moins un parallèle français avec cette enquête mexicaine ?
SB : C’est certes une histoire populaire mais on ne peut pas nier la spécificité de l’histoire migratoire. Les trois premiers enfants sont nés en Algérie et les deux premières filles se font faites naturaliser. Tandis que le troisième, le garçon, est fier de son passeport vert. Les normes de comportement liées au mariage sont déterminées par la religion. Les destins matrimoniaux sont orientés : les filles sont vouées à se marier à un homme musulman, elles l’ont intériorisé, les deux premières sœurs aînées ne supportaient pas cette norme mais n’osaient pas aller contre. C’était l’obsession de la mère. La sœur aînée Samira s’est mariée dès qu’elle a eu son diplôme. Les garçons en revanche ont eu des enfants et vie de couple avec des femmes dites « françaises » : cela crée des différences dans les histoires familiales.
Question 8 : Quel intérêt de l’entretien du père par les filles et la question de la langue ?
SB : Elles ont pu lui faire raconter ce qu’il n’avait jamais fait : le départ à l’armée à ses 18 ans, de ses conditions de travail. Cet entretien est utile pour combler les trous, c’est une histoire par le bas de l’immigration. Le mot ticket revient toujours. Ce ticket était nécessaire pour partir en France, et il était donné par des grandes entreprises françaises comme Peugeot ou de BTP. Le patronat a cherché à recruter des immigrés pour casser la rébellion ouvrière. Il raconte la scène de l’attente : il est marié avec un enfant : il est dernier en bout de chaîne, c’est un copain qui lui donne un ticket. L’histoire de l’immigration il faut aller voir de près comment ça se passe.
Question 9 : Est-ce un ouvrage briseur de clichés sur les personnes d’ascendance algérienne/maghrébine ?
SB : C’est un sujet très travaillé, presque trop travaillé par une littérature très abondante. Jusqu’aux générations récentes, l’intégration est tranquille et silencieuse, sauf pour ceux qui sont entrés dans la délinquance. Ce livre a des capacités d’identification pour le lecteur. Briser les clichés n’était pas l’objectif de base. Dans l’histoire coloniale, on fait trop souvent comme si cette histoire est centrale au quotidien. Or, il est probable que le chômage, la mort en direct sur la 6 de Khaled Kelkal aient eu plus de poids et constituent plus de souvenirs traumatiques que la guerre d’Algérie pour les générations les plus jeunes. Ce qui se vit en France depuis 20-30 ans, les a plus construits que cette mémoire coloniale.
Question 10 : Pensez-vous à une suite ?
SB Pour être franc, j’avais proposé les longs entretiens bruts de Samira Belhoumi et ces entretiens vont faire l’objet d’une pièce de théâtre qui va être jouée dans les lycées et à Sciences Po Lille.
Questions de l’auditoire
Pourquoi le père ne parle pas à ses enfants ? Parle-t-il à ses petits enfants ? Est-il plus bavard en devenant retraité ?
SB : Le père devient très vite COTOREP et va s’occuper de son jardin ouvrier, au point d’être récompensé en 2012. Il ne revient pas sur son passé en Algérie. Ce qui est intéressant c’est sa présence. Les deux sœurs aînées ont relu le livre sur version word et elles m’ont signalé que j’oubliais la présence du père concernant les trois garçons. Le père surveille de près la vie de ses garçons, il convoquait chacun de ses enfants garçons pour faire « son tour », pour évoquer tous les aspects de la semaine. Et une fois, le père a parlé à son fils des préservatifs dans une époque touchée et marquée par le SIDA. Samira l’appelle le « philosophe analphabète » : il parle avec des dictons. Le père parle à sa manière, il ne va pas demander les notes, mais il est présent.
Il ne peut pas parler à ses petits-enfants parce qu’il ne parle pas français, et les petits enfants ne parlent pas arabe. Il en souffre beaucoup. À la fin des années 1990, le couple Belhoumi a suivi une formation continue en français pour alphabétiser les vieux immigrés. Toutefois, il y a eu une pression des groupes religieux prônant un islam rigoriste qui ont séparé les publics hommes et femmes. Il a donc arrêté la formation préférant être avec son épouse. C’est une anecdote significative de l’évolution du quartier. Le couple n’aime pas l’évolution religieuse du quartier menée par la 2e ou 3e génération qui impose une religion qu’ils ne comprennent pas.
Quel regard les parents portent-ils sur le livre ?
SB : Mme Belhoumi n’a pas lu le livre mais M. Beloumi a eu droit une lecture du livre (en arabe) par Samira lors du mariage de la petite dernière, trois mois après la publication. Le père apparaît surtout dans la première partie et il commentait la traduction arabe de sa fille. Les parents ont été contents : « c’est vrai ». Rien de faux.
Compte-rendu réalisé par Noémie Lemennais
***
Café virtuel du 24 février 2021 : Etienne Peyrat, Histoire du Caucase au XXe siècle, Paris, Fayard, 2020.
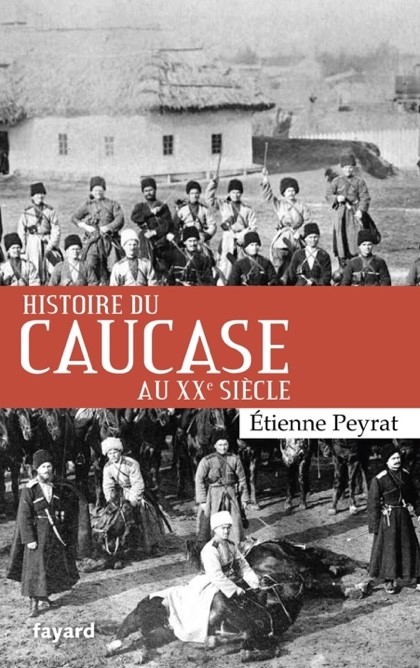
Animation par Ivan Burel, doctorant à l’IRHiS (Université de Lille)
Etienne Peyrat, maître de conférences en histoire contemporaine à l’IEP de Lille, est spécialiste des relations internationales. Il a consacré son intervention à l’histoire du Caucase, auquel il a consacré sa thèse et un ouvrage paru récemment chez Fayard, Histoire du Caucase au XXe siècle (2020). Seront envisagées les rivalités et les enjeux de pouvoir au sujet des territoires caucasiens dans leur profondeur historique, ainsi que les représentations qui les accompagnent. Au cœur des relations entre Russie, Turquie et Iran, le Caucase est à la fois un territoire de contacts et de confins, de circulations et de confrontations. Les espaces frontaliers caucasiens cristallisent et incarnent dans l’espace les héritages de ces conflits.
Pourquoi écrire une histoire du Caucase ? Historiquement, ce n’est pas une région de grande préoccupation pour la France. Jusqu’à l’heure actuelle, peu de travaux y sont consacrés.
Propos sur la couverture : sur la couverture se trouve une image stéréotypée du Caucase, qui renvoie à sa topographie. Ce sont des cosaques du nord-Caucase qui sont représentés – avec une vision de la région ancrée dans l’espace russe, périphérie d’un espace politique impérial.
Le Caucase est souvent abordé à l’aune de la conflictualité, de la guerre. Le but de l’ouvrage est d’envisager l’histoire du Caucase sous un autre angle. Trois objectifs principaux sont développés : d’abord, étudier le Caucase comme une région de frontière, qui n’est pas vue que dans la perspective russe, au prisme de géographies variables (à la fois humaines, économiques et politiques). Il s’agit de voir comment le Caucase est lié à l’Empire ottoman, à l’espace iranien, et a des connexions avec l’Asie centrale et le Moyen-Orient. Il s’agit aussi de voir comment sur un siècle, le Caucase a perdu en ouverture, en diversité, pour devenir ce que nous voyons aujourd’hui : en somme, la transformation d’une zone de confins ouverte à une zone plus fermée. Deuxièmement, le but était d’écrire une histoire du Caucase qui ne se limite pas à une description géopolitique, avec l’idée d’un contrôle uniquement depuis les grandes capitales. Le but est d’intégrer les acteurs régionaux : les élites administratives ou les acteurs plus politiques ou culturels, économiques. Enfin, troisièmement, il s’agit de ne surtout pas réduire l’histoire du Caucase à une histoire des conflits.
Sans être exhaustif, il s’agit d’étudier quelques jalons de l’histoire de la région, de la Première Guerre mondiale à la genèse du conflit actuel entre Arménie et Azerbaïdjan. Le début du XXe siècle permet de voir le Caucase comme une zone de grande diversité, ethnique, religieuse, linguistique, politique, très bouleversée depuis la fin du XIXe siècle par une transformation socio-économique rapide, malgré la situation de marge dans l’empire tsariste. Par exemple, la transformation de Bakou du fait de l’industrie du pétrole, ou encore le développement des industries extractives dans la Géorgie et l’Arménie actuelles. Ces transformations s’accompagnent de migrations à la fois externes et internes à l’empire. Ces transformations s’accompagnent d’une forme d’affaiblissement de la cohérence locale : des rixes entre communautés avec des rivalités sous-jacentes (contrôle d’un secteur d’activité, questions de salaires, d’emploi ou de commerce par exemple) se combinent à des questions politiques ou religieuses. Ce qui a pour conséquence un terreau instable, tendu.
Au début de la première Révolution russe, il y a une combinaison d’échelles : à côté du contexte impérial éclate une guerre civile régionale, avec l’effondrement du tissu social local et des affrontements entre groupes arméniens et turcophones musulmans de la région. Ces phénomènes coïncident avec l’effondrement de l’autorité officielle tsariste : il y a une combinaison de défiance, à la fois vis-à-vis du pouvoir et entre communautés. C’est dans cet arrière-plan d’expériences de violences internes, révolutionnaires que la Première Guerre mondiale survient.
Le génocide commis contre les Arméniens attire l’attention sur la question des minorités dans ces confins caucasiens. Aucun des belligérants n’est totalement sûr de lui. Chacun a recours à certains groupes dans l’effort de guerre. Les minorités sont au cœur de l’attention, qu’on veuille les utiliser pour l’effort de guerre ou les réprimer. Le génocide est le point paroxystique de cette attention portée aux groupes minoritaires. Du côté de l’Empire ottoman, la logique génocidaire est liée à une autonomisation de l’appareil politique jeune-turc, qui est le cœur de cette répression. Du côté russe, des contrepoids émergent. La Première Guerre mondiale est marquée par la violence, les occupations. Entre l’été 1915 et 1917, les forces tsaristes occupent une partie de l’Anatolie ottomane, où a été perpétré le génocide. Sur fond d’épuisement des acteurs, 1917 est le moment d’ouverture du cycle politique du Caucase au XXe siècle. Le Caucase est alors pour la première fois confronté à la question de sa relation avec les différents centres impériaux, puisque la relation avec la Russie ne va plus de soi avec l’arrivée au pouvoir des bolchéviques.
Au-delà de la constitution de nouvelles entités territoriales, des conflits émergent sur la question de la définition des frontières. Au moment de la période des premières indépendances caucasiennes entre 1918 et 1920 se dessinent des conflits qui persistent jusqu’à aujourd’hui, comme le Karabagh. Les acteurs extérieurs à la région comprennent mal la situation. Les enjeux de terrain se combinent à des négociations internationales. La période de premières indépendances est fondatrice, et reste associée à des blessures, des acteurs majeurs, des succès. Après la stabilisation dans les empires, le Caucase se trouve dans l’orbite d’autres acteurs : la soviétisation entre 1920 et 1921, qui s’accompagne d’une (re)conquête par les bolcheviques. On parle de « réintégration ». Les bolchéviques n’ont pas inventé le capharnaüm du Caucase autour de 1920 ; il ne s’agit pas d’une volonté caricaturale de leur part de « diviser pour mieux régner ». Ils répriment, mais il y a également des tentatives de structurations territoriales et nationales pour doter les différents groupes d’institutions, de territoires propres, avec une certaine représentativité culturelle et politique. Par exemple, on peut citer la création du Karabagh qui est une zone que les bolchéviques ont cherché à autonomiser et à rattacher à une plus grande entité. Il n’y a pas de machiavélisme bolchévique ou stalinien concernant cette question. Une des idées du livre est de montrer comment cette zone de frontières, marquée par l’ouverture et les circulations, se ferme dans les années 1930. Les intérêts soviétiques ont pu rencontrer ceux des Iraniens ou des Turcs, menant à une forme de consensus tacite entre les acteurs autour de la fermeture de cette frontière. Cette fermeture n’est donc pas le résultat d’une politique unilatérale soviétique.
Concernant la genèse du conflit actuel entre Arménie et Azerbaïdjan : le moment où les tensions réapparaissent se situe à la fin des années 1980, dans le contexte de la Perestroïka. Il s’accompagne de mobilisations contre le pouvoir soviétique et les violations des droits des nationalités. En 1987, le conflit du Karabagh éclate sur fond d’une évolution de la région – celle qui touche l’URSS mais aussi l’Iran et la Turquie. Les années 1980 sont une période d’agitation forte pour tous ces espaces. Le Karabagh et son rattachement à l’Azerbaïdjan sont vus comme un exemple de violations des nationalités par les Soviétiques. A Bakou dès 1988 éclatent des violences contre les Arméniens, dont des pogroms. Cette montée des tensions se fait sur fond d’affaiblissement des autorités soviétiques.
L’effondrement du régime soviétique est central pour le conflit, qui gagne ainsi en intensité. Dans les années 1990, le Caucase est une région en ruines : la famine revient, les déplacés sont très nombreux. Des formes de morcellement s’accroissent. Contrairement à une idée récemment répandue, la période qui s’étend entre la première guerre du Karabagh en 1994 et le début de la nouvelle guerre à l’automne 2020 n’a pas été une période de gel. Il y a eu des affrontements armés. La situation a donné lieu à beaucoup de tentatives de résolution. Toutes les négociations ont échoué car les acteurs qui les ont négociées ont été mis en situation de minorité, menacés par les nationalistes les plus durs. L’accord qui est en train d’être mis en place est le résultat du renversement des rapports de force.
Compte-rendu réalisé par Sihem Bella
Les comptes-rendus peuvent être téléchargés en cliquant sur le fichier suivant :
© Historiens & Géographes - Tous droits réservés. 03/07/2021












 Agenda des événements culturels →
Agenda des événements culturels →
