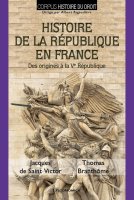1. C’est la première fois qu’une histoire de la République, des origines à la Ve, paraît en France. Le résultat est monumental et le contenu précieux pour les historiens comme pour les politistes, les juristes. Pourriez-vous revenir sur la genèse du projet ?
La genèse de ce livre, écrit avec Jacques de Saint Victor, débute par une rencontre : lors de ma thèse, j’étais ATER à Paris VIII, au lieu de traiter classiquement, en première année, de l’histoire des institutions de Clovis jusqu’à 1848, on me propose de faire un cours sur l’histoire de la République. Jacques de Saint-Victor en est le titulaire et comme ATER j’en assure les TD ; nous rencontrons un franc succès auprès des étudiants. Le projet est accepté par Economica au début de 2014 mais ce qui devait être un manuel est devenu quelque chose de plus ample, de plus ambitieux, plus profond qui a duré cinq ans ; aucune autre histoire de la République ne traitait des origines à la Ve République : malgré la grande qualité de nombreux travaux historiques, la place était vide, la tâche immense.
2. Les chapitres du livre ne sont pas signés : vous êtes-vous partagés la rédaction ou avez-vous écrit ensemble ?
Jacques de Saint-Victor et moi avons décidé d’être solidaires de tout dès le début du projet. Dès que nous sentions un nœud, nous en discutions. Au lieu d’élaborer une synthèse molle, nous cherchions le dépassement. Tout chapitre était transmis à l’autre qui le relisait, ce qui entraînait un travail de réécriture régulier. La dernière année, il y a eu de nombreux moments où nous avons relu ensemble nos textes pour être sûrs que nous étions d’accord sur les mots. L’introduction et la conclusion ont été écrites à quatre mains pour arriver à la pensée la plus juste qui soit.
3. On lit souvent que la République est née en septembre 1792. Ce n’est bien sûr pas le cas mais c’est un régime qui reste encore relié, dans les représentations, à la Révolution française. Pouvez-vous retracer l’histoire de la République et l’histoire de l’idée républicaine pour les périodes qui précèdent, de l’Antiquité à l’aube de la période contemporaine ? Et comment l’inimaginable, à savoir un grand Etat transformé en République, est-il finalement rendu possible dans la France révolutionnaire ?
Pour la première question, nous avons un présupposé qui sous-tend tout le livre : parler de la République en France, ce n’est pas seulement parler de la question institutionnelle. Nous voulions l’évoquer en tant qu’historiens du droit mais nous voulions aussi traiter de la question constitutionnelle, des événements et des idées. En acceptant de penser la République pas seulement sur son versant institutionnel, il nous est apparu qu’à l’inverse d’un livre écrit il y a quelques années par Jean Pétot (Les grandes étapes du régime républicain français (1792-1969)) où il commençait seulement en 1792, s’arrêtait en 1899, reprenait en 1848, nous nous considérions qu’entre 1814 et 1848 il y a toujours de la République. Cette République, après avoir lu les travaux de de Jeanne Gilmore [2], de Georges Weill, nous avons décidé de l’appeler la « République souterraine », « clandestine », une « nuit de la République » ; car la République existait toujours, même sous le Second Empire. On ne peut comprendre la République en 1848 ou le moment 1871 sans avoir saisi les évolutions et les mutations de l’idée républicaine. De la même manière, l’idée de dire que la République s’arrête en 1799 ne nous convenait pas et nous voulions traiter de la question républicaine sous l’ère bonapartiste. Nous souhaitions aussi remonter plus en amont, pour retracer la formation de l’idée républicaine, revenir sur les moments où les Républicains n’ont pas de République.
La proposition de notre livre, que l’on trouve aussi dans l’école de Cambridge, avec les travaux de John Pocock ou de Quentin Skinner, c’est de voir les débuts de la République dans les travaux de Platon – on pense bien sûr à sa République - et chez Aristote : ce dernier, en travaillant à la question du meilleur des régimes, pose déjà la question du bien commun. Pour être un bon régime, il faut gouverner en vue du bien commun : c’est à nos yeux la première définition républicaine, minimale mais constitutive. Cette idée passe à la République romaine qui, à partir de 509 avant notre ère, s’oppose à la royauté qui a viré en tyrannie sous la dynastie des Tarquins. Les Patriciens décident d’élaborer un nouveau régime fondé sur la séparation des pouvoirs, l’importance du droit et l’interdiction de la tyrannie. C’est la Respublica. A Rome, Cicéron complète cette définition dans son De Republica : la chose publique c’est la chose du peuple. Qu’entend-il par « peuple » ? Il fait la différence entre la plebs (plèbe, au sens social) et le populus, le peuple, au sens politique : celui qui vit sous une loi commune.
L’idée à laquelle l’historiographie était attachée depuis une trentaine d’années était que la République traversait une sorte de tunnel historique à la faveur de l’expansion du christianisme, après l’effondrement de l’Empire romain et l’avènement d’une tradition monarchique en Occident, du Ve au XVe s. Mais à la fin du Moyen Age, dans les cités italiennes, de nouvelles sociétés émergent ; que ce soit à Florence ou à Venise, l’idée de République ressurgit. Le terme de République désigne alors le symbole de l’Etat, de la chose commune. Malgré tout, dans ces cités italiennes des XVe et XVIe s., on approfondit des notions héritées de l’Antiquité, comme la question de la citoyenneté qui s’oppose à la notion de sujet de la monarchie. Et dans la citoyenneté se trouve aussi la question du vote.
Machiavel, quand il réfléchit au meilleur des régimes ou au vote, cherche son influence chez les auteurs classiques. Il redécouvre Polybe et Tacite ; il ne perçoit pas toujours leur lecture fantasmée de Rome et trouve chez ces auteurs l’idée que la grandeur de Rome vient de son rapport institutionnel, d’une division en trois parties : à la fois les consuls, le Sénat et les comices du peuple. Ce caractère mixte fonde le meilleur des régimes selon Aristote, c’est la politeia. Il existe donc une filiation intellectuelle, par-delà les siècles, entre Aristote, la Res publica romaine et les cités italiennes. C’est ce que John Pocock appelle « le moment machiavélien » : c’est à la fois cette formation de l’idée républicaine - par le passé - mais aussi la généalogie qui germe alors en Europe. En effet, la pensée de Machiavel (notamment le Discours sur la première Décade de Tite-Live) va être lue par des auteurs anglais du XVIIe s., un peu avant et surtout après la Révolution de 1649 qui donne le Commonwealth de Cromwell (aussi appelé « République ») et qui donne des auteurs comme Sidney ou comme James Harrington. Dans leur pensée, le meilleur des régimes est une forme de république au sens d’un régime mixte. On discerne cette influence à partir de la Glorious Revolution : le système anglais comporte bien un élément monarchique, un élément démocratique, on est bien dans un régime mixte.
Cette filiation se prolonge outre-Atlantique, chez les Etats-uniens. Les pères fondateurs mettent en place un régime qui n’est pas une démocratie – John Adams le précise bien - mais une République ; le mot devient rapidement plus clair : ils mettent en place un élément monarchique (un Président), un élément aristocratique (le Sénat) et un élément démocratique (la chambre des députés). C’est ce qui permet la résurgence d’un néo-républicanisme.
Pourquoi la France avait-elle été oubliée de cette tradition ? Notre hypothèse, avec Jacques de Saint-Victor, c’est que dans un contexte idéologique très fort où l’on cherche, en Angleterre, à échapper à la fois au communisme et au libéralisme (et au néo-libéralisme hayekien qui commence à être triomphant), il faut trouver une troisième voie. Si on replace le néo-républicanisme permet les excès de l’un et de l’autre selon ces auteurs. Mais si l’on reprend le schéma avec des éléments du puzzle français, au moment où des écrivains français comme François Furet disent que la républicanisme rousseauiste et le jacobinisme servent de matrice à 1917, donc du marxisme communiste russe et du totalitarisme, cela ne peut fonctionner. Nous avons donc renoué avec la tradition française, celle qui apparaît chez Bodin mais aussi chez Rousseau. La tradition française, nous voyons sa genèse avec Thomas d’Aquin redécouvrant Aristote, cherchant le meilleur des régimes, ce que l’on appellera une monarchie tempérée, souhaitant intégrer autour du roi d’autres éléments.
Les Etats généraux du XIVe s., notamment ceux de 1356, donnent une forme d’effectivité à cette réflexion : la vacance du pouvoir, autour d’Etienne Marcel, permet de penser un régime qui s’appuierait sur l’avis du peuple et sur la limitation de la monarchie française. Cela dure assez peu de temps, c’est une tradition assez confidentielle mais elle existe et nourrit une contre-tradition à l’absolutisme. Il y a un contrefort qui nourrit de manière lointaine les XVIIe et XVIIIe s., même si ces siècles sont aussi nourris par d’autres traditions, avec les influences hollandaises, le moment spinoziste, celui des républicains anglais. Ce n’est pas la naissance d’un courant républicain tel qu’on le définit aujourd’hui mais cela nourrit une réflexion qui s’étoffe avec Boulainvilliers et Condorcet – qui regarde du côté de la République américaine. La première grande rupture épistémologique, c’est Rousseau qui conduit à ce que nous appelons « l’exceptionnalisme français ». Selon Rousseau puis les Jacobins, la République ne peut être que démocratique ; Rousseau reprend Aristote en disant qu’elle doit être le bien commun mais aussi la souveraineté exprimant la volonté générale du peuple. Rousseau reprend la tradition bodinienne – sans craindre, comme chez Bodin la dislocation du royaume dans un contexte de guerre de religion, sans vouloir réaffirmer la puissance du roi. Rousseau puis les Jacobins reprennent cette souveraineté mais souhaitent donner de la souveraineté au peuple, tout en précisant qu’elle est puissance absolue, perpétuelle, indivisible. Ce qui va donner les caractères de la République française, qui doit être démocratique, émanation de la souveraineté du peuple, perpétuelle et indivisible.
4. De la Révolution et des expériences politiques nées entre 1792 et 1802 naissent finalement trois grands modèles de République expérimentés en France : la République libérale, la République sociale et la République autoritaire, genèse des modèles autoritaires du XXe s., de nombre de dictatures occidentales. Peut-on revenir sur les projets et les moteurs de ces trois types de République, sur les principes et les valeurs qui réunissent ou opposent ensuite, parfois durablement, les Républicains ?
Tout le problème de la République, c’est qu’elle n’est pas encore pensée, au moment où la Révolution éclate, comme un régime qui doit advenir et dont on aurait déjà une architecture déjà établie. La République française est fille des circonstances : en 1791 encore, un an avant la proclamation de la République, des figures aussi notables que Robespierre, lorsqu’ils entendent au Club des Cordeliers la proposition de la République, y voient un piège des contre-révolutionnaires, une forme d’outrance qui, agitant les esprits, amènerait une forme d’anarchie. Robespierre craint ce régime de l’inconnu, cette sorte de saut dans le vide qui pourrait mener le processus révolutionnaire à sa fin, le peuple étant conservateur.
La révolution, en 1789, se produit grâce à la conjonction des crises de subsistance, de la décélération économique, du déficit puisque les caisses sont vides, Necker amenant à la convocation des Etats généraux qui n’avaient pas eu lieu depuis 1614. Mais qu’est-ce qui est important pour notre histoire républicaine ? Ce sont les mots qui catalysent le parti patriote : la nation (héritée notamment de l’abbé Sieyes et Qu’est-ce que le Tiers-Etat ? de janvier 1789), l’idée de Constitution et l’appel à la liberté et aux droits de l’homme. Le terme de « République » n’est pas encore employé à ce moment-là. Lorsque le 17 juin, le Tiers-Etat se proclame assemblée nationale, c’est le début de la révolution juridique qui commence. C’est le début d’une prise de souveraineté, qui découlait jusque-là du ciel et de Dieu. La nation s’auto-sacre, se présente comme souveraine alors que le roi ne perçoit pas le sens de ces événements. Alors que la révolution est déjà à demi-faite, et les députés demandent à élaborer une constitution, avoir des droits de l’homme et une représentation nationale permanente. Presque tout cela est acquis à partir de 1789 et à partir de la mise en place d’une assemblée constituante en juillet. Ce qui complique tout, ce sont les incertitudes de Louis XVI qui le mènent au double-jeu, la crise de subsistance créant un espace extrêmement éruptif, la montée de pensées et d’actes contre-révolutionnaires qui entraîne des complots, des assassinats et enfin la guerre à partir du 20 avril 1792. Il y a aussi un processus révolutionnaire où un groupe chasse l’autre : faut-il parler en termes de classe ? Au début ce sont les parlementaires qui ouvrent la porte de la révolution, suivis des aristocrates, suivis de la bourgeoisie puis du peuple.
En 1792, la guerre et ses incertitudes militaires rendent la situation intenable ; le double-jeu de Louis XVI et de Marie-Antoinette est évident. La crise de Varenne, en juin 1791, a constitué un tournant de la révolution, propagé le doute sur la monarchie ; on ne peut poursuivre la révolution avec le roi et on commence à penser à la République. Des hommes comme Condorcet chez les Brissotins commencent à le penser, c’est aussi le cas de Robert du côté des Cordeliers ; une pétition est proposée par les Cordeliers, en juin 1791 sur le Champ de Mars, pour destituer le roi et proclamer la République. Cette idée infuse dans la pensée de l’avant-garde révolutionnaire et il y a une suspension du roi à partir du 10 août.
Si on tente une classification en termes de sensibilités, les Girondins sont un peu plus libéraux que les Montagnards. Si on veut penser un moment libéral, c’est entre 1789 et 1792, autour des droits de l’homme, autour d’un républicanisme qui ne dit pas son nom, autour de figures comme La Fayette, inspiré du républicanisme américain, alors qu’on s’oriente vers une monarchie constitutionnelle… mais qui n’est pas une république. Y-a-t-il du républicanisme libéral à ce moment-là ? Oui dans certains esprits, mais non au niveau du régime institutionnel et du droit. A partir de 1792 et la Convention qui se met en place comme organe unique arbitrant les destinées de cette République naissante, les Girondins sont le groupe majoritaire entre septembre 1792 jusqu’à leur chute le 2 juin 1793. Mais toutes les pensées sont tournées vers la guerre et tous craignent de voir la Révolution et la République anéanties. Il s’agit de sauver le vaisseau révolutionnaire et son jeune mât républicain. Les Girondins essaient de trouver un équilibre, des logiques de compromis ; d’autres vont trouver une force, une vigueur, une radicalité pour éliminer les ennemis de cette République, ce sont les Montagnards.
Pour mieux les cerner ou les distinguer, on peut ajouter un ethos un peu plus bourgeois chez les Girondins que chez les Montagnards ; une provenance un peu moins parisienne (mais ce n’est pas si évident) et il y a la question du fédéralisme qui viendra plus tard (qui pose aussi la place de Paris et des sans-culottes dans le processus révolutionnaire). Les Girondins vont essayer de de stabiliser la révolution ; Vergniaud dira que les Girondins sont des modérés. Mais le dieu de la Révolution est comme le dieu de la Bible, il vomit les modérés. Les sans-culottes, de plus en plus importants, renversent les Girondins, trop modérés. Alors que les Montagnards se sont alliés aux sans-culottes, ils sont entraînés vers une certaine politique sociale : il y a la loi sur le maximum, l’idée d’une économie dirigée, le soin accordé aux pauvres, aux veuves de guerre, l’idée d’avoir une armée plus égalitaire avec Saint-Just. Le moment montagnard, comme le moment jacobin, est animé par un souci d’égalité ; c’est une remise en cause des privilèges et des injustices.
Mais attention aux anachronismes : on est en guerre. Même s’il y a une inspiration rousseauiste dans les discours de Robespierre - on peut sur ce point renvoyer aux travaux de Florence Gauthier - les Montagnards et les Jacobins n’ont pas le temps d’esquisser une politique économique idéale qui prévaudrait en temps de paix. L’urgence de la guerre préside aux décisions. C’est la guerre qui forge, sur un arrière-fond de crise économique, un ethos jacobin : on peut le définir par la souveraineté du peuple qui devient l’aiguillon de toute politique, mais aussi par la passion de l’égalité (dans un premier temps surtout juridique), par la loi comme expression de la volonté générale. Il y a aussi une manière de penser les choses avec radicalité, selon un jusqu’au-boutisme hérité de l’Antiquité qui peut mener à la mort pour la République.
Le 9 thermidor entraîne une contre-réaction entre 1794 et 1799, d’abord dans la Convention thermidorienne puis un nouveau régime qui est le Directoire – mais Georges Lefebvre ou François Furet ont montré que c’étaient les mêmes qui s’étaient maintenus au pouvoir. C’est ce que nous avons appelé, avec Jacques de St-Victor « la république désenchantée » : le maître-mot est alors de faire l’inverse de ce qui a été fait précédemment. Dans une vision marxiste, on a pu l’appeler « la République bourgeoise » ou « la République des notables » ; c’est surtout une république anti-jacobine. C’est une république conservatrice mais aussi une forme de la république du centre : Thibaudeau, l’un des maîtres à penser de cette nouvelle république, veut trouver une voie médiane entre la royauté et ce qu’il appelle la démagogie. Eux se considèrent comme républicains du centre, une voie moyenne comme le prouvent les paroles de Boissy d’Anglas ou de Constant.
Qu’est-ce qu’être républicain du centre ou républicain conservateur ? C’est être capable de mettre un frein à cette politique du peuple, par le peuple, pour le peuple. Il faut être capable de dire que le peuple n’est pas la boussole de toute action, qu’il n’est pas acteur lui-même de sa destinée. On réfrène le désir de démocratie populaire, on ferme les clubs, on pourchasse les Jacobins, Robespierre devient le bouc-émissaire ayant entraîné la République dans un moment à feu et à sang. On théorise la Terreur comme le fruit d’un petit nombre de cerveaux malades plutôt que de reconnaître que c’est le fruit des circonstances, porté par l’ensemble de la Convention. Pour reconstruire un équilibre, ils s’appuient sur les propriétaires, ce qui est pleinement assumé et ce qui leur vaudra, dans une vision marxiste, d’être accusés d’avoir installé une « République bourgeoise ». Boissy d’Anglas souhaite laisser faire les élites éduquées, ceux qui ont une forme d’éducation. Ils instaurent une forme de stabilité par la Constitution de l’an III : celle-ci revient sur le culte de l’unanimisme jacobin ; on établit un exécutif morcelé en cinq – les Directeurs - et un législatif divisé en deux – c’est le Conseil des Anciens et le Conseil des Cinq cents, c’est la naissance du bicaméralisme en France.
Tout le pari du Directoire, c’est de penser que les Français sont lassés de l’instabilité, du désordre, voire du chaos. C’est un bon calcul politique mais ils ne réalisent pas leur programme et sont infidèles à leur promesse : tout en voulant respecter une forme de système électif, ils se rendent compte que les élections ne vont pas en leur faveur. En effet, une partie de la droite royaliste bien organisée arrive à entrer dans les conseils : ils font un coup d’Etat pour prévenir une restauration légale par les urnes ; mais l’année d’après la gauche, rendue vigoureuse par cette politique contre la Droite, gagne les élections. Il faut alors mener un coup d’Etat contre la gauche. Après ce coup de barre à gauche puis ce coup de barre à droite, la troisième année est marquée par « la Revanche des Conseils contre les Directeurs ». Ne reste qu’une chimère de démocratie. Comme le dit Lucien Bonaparte, « la constitution de l’an III est un cadavre » ; personne ne souhaite la défendre mais il est impossible de la modifier avant neuf ans. Ce qui mène Sieyes à chercher une épée en la personne de Bonaparte, qui dupe Sièyes.
En 1799, la nouvelle constitution ouvre sur une République autoritaire, qui incarne le premier archétype de la République d’ordre. Ce régime cherche à stabiliser la situation politique, à travers une politique de main tendue à la fois aux Jacobins mais aussi aux Royalistes ; c’est aussi le Concordat, la paix des braves pour la Vendée, la possibilité pour les nobles et les émigrer de revenir. Bonaparte mène cette politique au nom d’une politique nationale – il déclare d’ailleurs « Ni bonnet rouge, ni talon rouge, je suis national ». Bonaparte œuvre à remettre la France en ordre, à rétablir une certaine concorde pour que tout le monde puisse vivre ensemble.
Sa deuxième politique d’ordre, c’est l’idée que la France a besoin d’architecture institutionnelle, constitutionnelle et juridique. Ce n’est pas tant la Constitution de l’an VIII qui importe mais l’œuvre juridique durable qui se met en place : le Code Civil en 1804, le Code pénal en 1810, le système administratif autour de la loi du 28 pluviôse qui redessine les départements et met à la tête de ceux-ci un préfet. Au début il s’agit surtout d’une république d’ordre. Mais le fait que Bonaparte soit un militaire et un génie objectif l’entraîne à demander une prorogation de son consulat. Dix ans ne lui suffisent pas pour ce qu’il est, il devient consul à vie en 1802 puis empereur en 1804. A quel moment s’arrête la République ? Est-ce que c’est en 1899 quand il prend le pouvoir, est-ce que c’est en 1802 avec le consulat à vie, ou en 1804 avec le sacre ? 1804 est un moment ambigu : sur les pièces de monnaie, il est écrit sur une face « Napoléon empereur des Français » mais de l’autre « République française ».
C’est la naissance du césarisme : c’est une nouvelle forme de République, un anti-parlementarisme hérité de César et de la crise de la République romaine. Napoléon reprend à plusieurs reprises la phrase de Sieyes : « la confiance vient d’en bas mais le pouvoir vient d’en haut ». La France n’est plus une monarchie où la légitimité vient de Dieu : on assume que le socle, c’est bien le peuple mais ce dirigeant ne se lie pas les mains à travers le suffrage universel. On noue une relation de confiance avec le peuple, une sorte de symbiose intellectuelle avec un contrat tacite : les Français remettent leur confiance mais Napoléon doit les rendre heureux. Le bonheur se trouve alors dans la gloire militaire, dans les frontières naturelles de la France, la prospérité économique et la stabilité politique. C’est ainsi que la République va s’abîmer, progressivement. A partir du moment où en 1795, on a demandé à la République d’instaurer une stabilité, qu’elle n’a pas réussi à la trouver malgré le caractère centriste et conservateur du régime, on préfère la stabilité dans une république incarnée qu’une stabilité dans une république divisée, divisible et instable. Sauf qu’en confiant la République à un seul, en la consubstantialisant à un seul, il devient simple de mettre un terme à celle-ci. A part Carnot qui refusa le Consulat à vie, il n’y avait plus personne pour s’opposer à la transformation du régime.
5. Au-delà de ces trois modèles théoriques, combien de sensibilités républicaines distinguez-vous en France ?
Avec Jacques de Saint-Victor, nous nous sommes demandés si nous n’avions pas eu tort de penser l’idée républicaine au singulier. En fait, il y a plusieurs traditions et sensibilités républicaines. Notre proposition est heuristique : les termes que je vais employer n’ont pas été employés par les contemporains, mais ils nous semblent utiles pour tracer des propositions, penser des généalogies de l’idée républicaine qu’il est possible de discuter, de contester ou de nuancer.
La première tradition c’est celle de la sensibilité libérale. Son étoile, c’est la liberté et notamment la liberté des individus ; ce qui explique la détestation de la tyrannie, qu’elle découle d’un être unique ou de plusieurs (c’est la vision des Libéraux vis-à-vis de la Terreur). Le droit, pour les républicains de cette sensibilité, agit pour eux comme une voûte ou un dôme permettant aux citoyens de vivre ensemble sans la tyrannie ; ils tiennent aussi à la séparation des pouvoirs. Dans les auteurs les plus importants de cette tradition, il y a évidemment Cicéron, un peu des Républicains anglais, mais aussi et surtout Montesquieu dont on connaît bien la phrase « C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ». Le risque de tyrannie doit être jugulé par la séparation, le contrôle ou la balance des pouvoirs et le droit. Cela va donner chez les Libéraux des penseurs qui se réclament de ce républicanisme anglo-saxon : un Condorcet, un Brissot – grand lecteur du républicanisme américain - ou un La Fayette qui a fait le voyage. Au XIXe s., ce sont surtout des figures qui se construisent contre le républicanisme jacobin, qui font en sorte qu’on ne revive jamais le gouvernement révolutionnaire. Parmi eux, on va trouver Armand Carrel (l’un des chefs de la République clandestine sous la Monarchie de Juillet), Lamartine en 1848, Jules Simon sous le Second Empire, Jules Ferry sous la IIIe République.
Ensuite on passe au deuxième républicanisme, au grand opposant au républicanisme libéral, c’est le républicanisme jacobin qui se définit par la souveraineté du peuple, la passion de l’égalité, la loi comme expression de la volonté générale et une sensibilité à la question sociale qui, sans être marxiste au début, s’intéresse aux pauvres, aux « malheureux » (Saint-Just dit « les malheureux sont les puissances de la terre »). La tradition jacobine n’est pas très ancienne, même s’il y a sans doute des éléments ou des correspondances des temps à trouver chez Spinoza ; chez une partie de Mably (qui peut aussi être cité par les Libéraux) puis enfin Rousseau. L’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme (« la loi est l’expression de la volonté générale »), c’est du Rousseau pur jus. Le fait, en permanence, chez les Jacobins, de convoquer le peuple vient aussi de Rousseau. Robespierre, St-Just et Danton ont eu à vivre ces questions sociales. C’est sans doute le républicanisme le plus identifié, voire, pour certains chercheurs, le plus pur, celui qui fonde la République de 1792 puisque même les Girondins sont d’abord des Jacobins. Il faut y ajouter un esthétisme lié à un goût de la parole, une capacité à embraser les cœurs, une capacité sacrificielle très grande, un goût de la mystique républicaine que certains Libéraux n’apprécient pas du tout. Ces grands jacobins sont Robespierre, Saint-Just et Billaud-Varenne ; sous la Restauration des gens comme Ledru-Rollin, Eugène Cavaignac - le frère de Godefroy, un héritier du néo-jacobinisme. En 1848 on a des figures comme Louis Blanc et des hommes qui dans l’Assemblée vont se nommer « la nouvelle montagne » ; enfin sous la IIIe République des hommes comme Gambetta et Clemenceau.
Face à eux, troisième catégorie, celle des Plébéiens : ils sont parfois difficiles à distinguer des Jacobins car ils ont une cellule souche commune avant de connaître des divisions. Les premiers plébéiens, ce sont ceux qui débordent le jacobinisme par sa gauche, ceux que l’on trouve parmi les Enragés et les Hébertistes (« les Exagérés » selon Robespierre). Qu’est-ce qui les distingue des Jacobins ? Ils partagent le culte de l’égalité, de la loi. Mais les Plébéiens sont des héritiers de la pensée antique du cosmopolitisme. Ils rêvent d’une république universelle. Anacharsis Cloots écrit un pamphlet, La République du genre humain ; il rêve d’une république qui soit partout, au-delà des frontières… Là où les Jacobins, du fait de la guerre, voient l’importance des frontières. Hormis ce cosmopolitisme face à un certain amour de la patrie (mais un amour qui n’est pas ethnique et tient plutôt à la « communauté des affections »), il y a aussi le rapport à la propriété. Beaucoup de Plebéiens souhaitent la disparition de la propriété : c’est par exemple le cas de Babeuf alors que les Jacobins veulent une république de petits propriétaires. Il y a aussi l’ardeur : les Jacobins savent qu’il faut être homme d’Etat, diriger. Les Plébéiens sont dans une révolution, une combustion permanente. On espère que les laves de la Révolution, en se refroidissant, créeront des tables de loi. Mais on est dans la combustion. Leur esthétique diffère : les Jacobins assument un soin dans l’habillage, Robespierre et sa perruque sont poudrés ; les Plébéiens veulent sortir des entrailles du peuple, sont habillés à la manière du peuple, peuvent assumer des traces de gras sur leur chemise, fréquentent les tavernes du peuple. Il y a aussi le verbe, une manière tribunicienne de parler qui rappelle la défense de la plèbe par les « tribuns de la plèbe » sous la République romaine. Il y a une volonté d’utiliser des mots venant de la grammaire populaire, avec Hebert qui dans son journal utilise des mots comme « foutre », qui fait souvent référence à la sexualité, attaque le roi et la reine en-dessous de la ceinture…. Là où les Jacobins sont des héritiers de l’art oratoire antique, de Démosthène, parce qu’ils sont les héritiers de la culture classique qui leur a été transmise au XVIIIe s.
Les Plébéiens sont des matérialistes athées radicaux alors que les Jacobins sont animés d’un certain déisme ou bien craignent de sortir de la religion pour des raisons politiques. On peut donc discerner une inspiration des Lumières radicales, du salon d’Holbach, du matérialisme qui se met en place au XVIIIe s.. Dans les grandes figures plébéiennes, il y a bien sûr Babeuf - son Manifeste des Egaux et sa Conjuration des Egaux en 1796, qui tente de renverser le Directoire - et ses disciples : il en va ainsi de Philippe Buonarotti, un conjuré qui survit et qui fait la passerelle entre la Révolution et le XIXe s, avec Blanqui dont ce disciple de Babeuf devient proche. Les amis de Blanqui sont souvent décrits comme néo-babouvistes, mais pour nous ce sont des aussi des Plébéiens : même s’ils sont encore jacobins jusqu’en 1848, ils trouvent que les Jacobins s’accommodent un peu trop facilement avec le pouvoir, que des hommes comme Armand Marrast qui était entre le républicanisme libéral et le républicanisme jacobin finit par accepter d’être pleinement libéral. 1848, c’est donc le premier coup d’arrêt. Les Blanquistes espèrent plus de soulèvements, de révolutions, comme les amis de Barbès - même si Blanqui et Barbès ne s’entendent guère. La fin du républicanisme plébéien, c’est la Commune, quand survient le républicanisme conservateur qui finit par triompher. Le républicanisme plébéien, qui aura un peu coagulé avec le marxisme et l’internationalisme gardera les mêmes principes – l’égalité radicale, l’abolition de la propriété privée, l’athéisme radical, l’idée d’une révolution permanente… - mais on y ôte la République qui est tombée dans le giron des conservateurs.
La dernière sensibilité : c’est celle du républicanisme conservateur, un peu oxymorique. Puisque la République s’est définie contre la Monarchie jusqu’en 1792. Il faut donc conserver un ordre que certains veulent voir disparaître. Jusqu’au XIXe s., cela n’a pas de sens d’être un républicain conservateur. Mais en 1848 et en 1871, des hommes comme Guizot, les doctrinaires, Thiers se demandent s’il y aura vraiment une vraie différence entre la république conservatrice et la Monarchie de Juillet. Ils investissent l’Assemblée en mai 1848, là où on trouve des « Républicains du lendemain ». Le troisième moment qui est vraiment son avènement, c’est la Commune de Paris : Thiers veut une République conservatrice, est persuadé qu’il faut, plutôt que d’être un ennemi de la République, pratiquer l’entrisme de l’intérieur, la transformer, y ajouter leurs critères - le goût de l’ordre, de la prospérité économique, l’attachement aux piliers de la société que sont l’armée, la famille, la religion.
6. Cette année, l’histoire politique du XIXe s. revient en force dans les programmes de lycée : même si ceux-ci sont très ambitieux, on peut espérer que la République ne sera plus un vain mot. En tant qu’historien de la République, comment expliquez-vous le désintérêt pour l’idée républicaine ? Comment revivifier aujourd’hui l’idée républicaine ?
Sur le désintérêt - ou le désamour - de la République, il y a trois choses. D’une part, la République n’a pas été à la hauteur de ses promesses. La République pose un idéal tellement grand, peut-être inatteignable, qu’elle déçoit souvent. Le désamour me semble donc lié à la déception d’une République parjure à ses promesses et à son idéal.
Par ailleurs, il y a eu une forme de confusion idéologico-mentale sur plusieurs notions. Nous vivons une époque extrêmement déterminée et caractérisée par ce que l’on peut appeler la pensée anti-totalitaire, qui émerge après la Seconde Guerre mondiale et trouve son acmé dans les années 1970 ; à la suite des travaux d’Arendt, on s’attaque légitimement au fascisme, au nazisme mais aussi au communisme comme l’autre versant du totalitarisme. Dans les recherches que l’on mène sur les origines du totalitarisme, on distingue une antichambre dans le nationalisme, ou même le patriotisme. Or les premières graines de ce patriotisme et de ce nationalisme, certains chercheurs des années 1970-1990 en décèlent les germes dans la Révolution française, à travers le rejet de l’ennemi, la mise en place d’une première forme de pensée unique. Comme il y a une victoire hégémonique culturelle de la pensée anti-totalitaire, il y a un rejet – fort heureusement - du fascisme et du nazisme ou du soviétisme, mais aussi de toute notion de révolution, et une critique des révolutionnaires français, fortement liés aux origines du marxisme, est également entraînée dans l’abîme. Il y a aussi réflexion renouvelée sur l’Etat de la part des philosophes. Des penseurs qui interrogent et déconstruisent le rôle de l’Etat qui a pu fournir un solide appui à la possibilité du totalitarisme permis cette domination : Deleuze, Foucault, bientôt Bourdieu voient dans l’Etat un instrument de domination. Tout ce qui faisait les fondements du jacobinisme français est ainsi remis en cause : le culte de la Révolution, la souveraineté du peuple (puisque le peuple peut donner Hitler), l’amour de l’Etat, l’amour de la loi comme expression de la volonté générale devient même problématique : c’est ce que le droit appelle le moment de la pensée positiviste, au-dessus de la loi il doit y avoir des organes non-élus, non-démocratiques, des conseils de sages qui permettent que la loi ne soit jamais dans l’excès, en France c’est par exemple le Conseil constitutionnel. Donc tout est mis sous le boisseau jusqu’à l’égalité puisque la pensée américaine lui a substitué l’équité dans les années 1980.
Le troisième point de rejet, c’est la république incantatoire : des acteurs politiques qui reprennent la grammaire de la République mais qui ont souvent une visée électoraliste et qui convoquent la République à peu de frais, en employant des grands mots qui galvanisent les cœurs, entraînent des votes mais qui, puisqu’ils ne sont pas suivis d’effets, créent la désillusion. Voilà les trois raisons du désintérêt ou du désamour de la République.
Comment redonner du sens et faire aimer la République ? Il faut la revitaliser à travers deux choses, la re-signification et l’effectivité. La re-signification c’est redire son histoire – d’où ce livre. Il s’agit de montrer que le jacobinisme ce n’est pas la culture de l’Etat pour l’Etat, l’obéissance, l’écrasement des oppositions ; il faut montrer que le jacobinisme c’était la question de la souveraineté populaire, l’amour des malheureux, rappeler que le jacobinisme voulait un système de sociétés populaires pour faire remonter les informations de terrain, pour créer plus de démocratie locale.
Il faut aussi contextualiser, par exemple la douleur de citoyens qui ont vu leur langue matée au nom de la République. Il faut rappeler qu’au début de la Révolution, lorsque l’abbé Grégoire étudie la question du Français sur le territoire, un cinquième seulement de la population parle français : en mettant en place un nouveau régime, des droits de l’homme, de nouvelles lois et une nouvelle structure administrative, ils se disent qu’il faut absolument que les Français lisent, parlent ou comprennent la même langue, doivent pouvoir parler tous ensemble. Aujourd’hui, un Jacobin sait en revanche que le français est la langue commune dans l’hexagone et l’outre-mer ; un jacobinisme moderne peut assumer la différence et vouloir préserver les autres langues, qu’il s’agisse d’un Français qui parlerait aussi le catalan, le breton ou le corse ; il ne faut pas confondre l’unité et l’uniformisme.
On peut donc, grâce au passé et à la re-signification, chasse les idées fausses, revitaliser la République, rappeler que le républicanisme a été fondamental dans la lutte contre l’ordre injuste du monde, contre l’arbitraire de la justice ou l’impôt payé à 90% par le Tiers-Etat. Quand on dit tout cela dans les « quartiers », quand on dit cela à la jeunesse, ils comprennent qu’ils sont les fils de ces grandes figures révolutionnaires qui ont cherché à mettre en place un monde plus égalitaire. La jeunesse, étant souvent dans une position complexe économiquement, peut trouver dans ces grandes figures révolutionnaires une source d’inspiration, mesurer la force d’un projet généreux : bien des révolutionnaires du monde entier ont dit ce qu’ils devaient à la Révolution française. Il faut donc re-signifier la République par son histoire et ses moments glorieux, sans évidemment cacher ses ratés, sans oublier les promesses non-tenues ou les parjures : la colonisation, le racisme, l’antisémitisme… Et puis il faut revitaliser la République avec l’effectivité : il faut que tous les mots de la grammaire républicaine se traduisent par des réalités tangibles, par une transformation de la loi. Lorsque les libertés publiques sont menacées, il faut montrer qu’il y a atteinte à la République. L’égalité est vraiment mise à mal, on est souvent traité différemment en fonction de ses origines géographiques, sociales, de ses ascendants, selon qu’on est un homme ou une femme – qu’il s’agisse des salaires ou des inégalités face à la violence des conjoints, face à la mort avec la multiplication des féminicides ; ce sont des problèmes que les républicains doivent prendre à bras le corps, comme la fraternité dont il ne reste rien ou presque. C’est seulement quand la République - dont le corps est devenu grisâtre à force de ne plus avoir de sang qui circule, de sève, de vitalité - retrouvera une vitalité et des couleurs, donnant envie d’être aimée parce qu’elle est aimable, qu’elle recevra l’adhésion de tous et du commun.
© Joëlle Alazard, pour la Rédaction d’Historiens & Géographes - Entretien paru dans le n° 448 de la revue - Tous droits réservés. 04/01/2020.