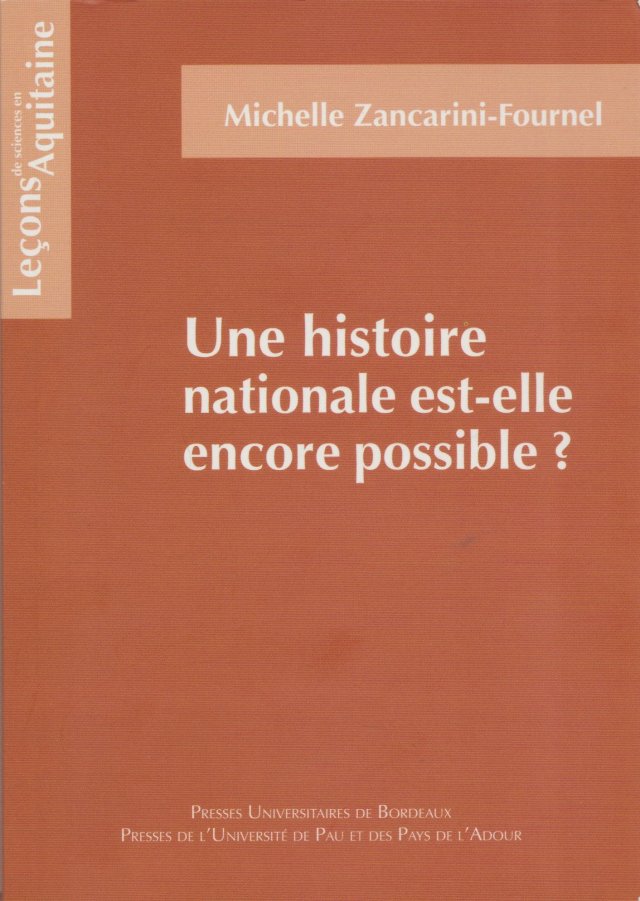À l‘heure de la refonte des programmes du lycée, l’interrogation fondamentale de ce livre épouse celle d’une partie du corps enseignant : est-il encore possible d’écrire (et donc d’enseigner) une histoire de France qui ne s’enferme pas dans les frontières hexagonales et qui ne convoque pas un peuple imaginaire ? La mondialisation et les évolutions historiographiques ne nous dictent-elles pas une histoire décentrée, c’est à dire non plus centrée sur l’Occident, mais une histoire qui la complète, la renforce et la contextualise ? Ainsi, contrairement aux rêves de certains ou aux peurs des autres, il n’y aurait pas de « grand remplacement » dans l’historiographie, seulement une manière plus globale de la penser et de la rédiger.
Il était une fois le roman national...
L’historienne plaide de fait pour une autre manière d’écrire l’histoire, qui « prenne en compte l’ensemble des populations de l’empire français des anciennes et nouvelles colonies ». Le livre commence par rappeler ce qu’est le roman national. On peut le définir comme le « récit patriotique édifié par les historiens du XIXe siècle » exaltant la grandeur de notre pays. Peu à peu complété par d’autres concepts (on pense à la repentance, concept forgé par Daniel Lefeuvre en 2006), il annexe également de nouveaux territoires et de nouvelles figures, comme celle de Charles Martel, dont l’instrumentalisation a été bien étudiée par William Blanc et Christophe Naudin (2015). Enfin, le rejet de la mondialisation et la peur de l’islamisme, le grippage du « creuset français », la promotion d’une conception « déhistoricisée » de la laïcité sont autant d’arguments justifiant, pour ses partisans, une histoire nationalo-nationale.
Bref, le roman national serait cette histoire à visée structurante, qui étudie l’ « avancée du temps dans un territoire en extension », rejetant sur ses marges des épisodes contraires à cette geste nationale. Il serait bon toutefois de rappeler que les adversaires du roman national tombent souvent dans le même travers que celui qu’ils dénoncent. On fait ainsi de Napoléon III le fossoyeur de la République (ce qu’il fut) en oubliant le plus souvent qu’il a acclimaté les Français au suffrage universel (restreint par la République, peu soucieuse en outre du sang des ouvriers et du droit des femmes) et qu’il a donné le droit de grève. Chaque vision de l’histoire a ses zones d’ombres. C’est d’ailleurs à ce titre, comme le rappelle l’auteure, que le refus du roman national s’exprime. La question coloniale, définie comme « la reconnaissance à la fois de la situation de domination subie par les populations colonisées... et les discriminations vécues par leurs descendants », alimente aussi l’hostilité face à cette conception de l’histoire. Le débat, on le voit, est complexe, inscrit en outre dans un contexte pluriel.
Une histoire plus connectée
Alors, que faire ? Pour l’historienne, il est nécessaire d’avoir une histoire connectée à celles du « genre, de l’immigration, l’esclavage, la colonisation... ». Cette connexion « change le récit historique global » en l’enrichissant de champs qui furent longtemps « autonomes et séparés ». Michelle Zancarini-Fournel dresse alors un rappel de l’historiographie de ces territoires placés en périphérie. Histoire des femmes, histoire du genre, histoire coloniale, histoire de l’immigration sont autant de sphères que l’historien se doit aujourd’hui d’intégrer. Il faut en terminer, écrit l’auteure, avec ces histoires séparées et « intégrer dans le récit historique global les expériences et les parcours de vie des migrants, des migrantes » et des colonisés. Un exemple est donné avec mai-juin 1968. Peut-on encore aujourd’hui rester focalisé sur la figure de « l’ouvrier mâle professionnel et français » alors que près de 900 000 immigrés travaillent au même moment dans l’industrie et qu’une fraction de ceux-ci a su s’intégrer dans « les structures revendicatives » ?
Une autre histoire nationale possible ?
Une autre histoire nationale est-elle alors possible ? Selon quelles modalités ? Deux exemples nous sont donnés. Le premier est offert par L’Histoire mondiale de la France, ouvrage collectif dirigé par Patrick Boucheron, qui, en 146 dates, dévide une trame événementielle de la grotte Chauvet aux attentats de janvier 2015. L’ouvrage commence donc l’histoire de France avant la France, se délestant ainsi de la quête des origines, tancée déjà par Marc Bloch. Le second est constitué par le livre Les luttes et les rêves. Une histoire populaire de la France (1685-2005). Ce titre illustre ce que peut être cette autre histoire que l’auteure appelle de ses vœux. Il s’agit d’une histoire au ras du sol, avec des figures ordinaires, évoquant les capacités de ces dernières à « comprendre, à interpréter leur monde et à le raconter ». L’ouvrage en question débute avec l’année 1685, nouvelle « année terrible » avec l’adoption du Code noir et la promulgation de l’édit de Fontainebleau qui interdit aux protestants l’exercice de leur religion. 1685 permet à la fois de s’intéresser à l’agency (Judith Butler) des populations et de mettre en évidence des « liens réciproques » entre la France continentale et les territoires colonisés.
À cet égard, 1686 est aussi une date signifiante. Un arrêt royal interdit de fabriquer, de vendre et de porter des « indiennes », ces toiles peintes ou imprimées. Or, des huguenots réfugiés en Suisse fabriquent ces toiles, échangées sur le littoral africain contre des esclaves. Ceux-ci déportés aux Antilles produisent la teinture bleu de ces « indiennes ». La volonté des consommatrices de porter envers et contre tout ces indiennes achève le cycle et montre que ces trois phénomènes apparemment « disjoints » sont reliés. Cet exemple souligne la méthode de cette autre histoire nationale : connecter des espaces, varier les temporalités et multiplier les échelles d’analyse, afin de donner « de l’intelligibilité à des circuits et à des situations complexes ». D’autres exemples sont donnés de cette écriture qui apporte une plus-value à notre compréhension des événements et à l’histoire des « gens d’en bas » (Edward P. Thompson), ceux dont on dirait aujourd’hui qu’ils se trouvent du mauvais côté de la rue, mais sans qui l’histoire, avouons-le, n’aurait guère de chair voire de sens.
Ce petit livre, rappel utile d’une historiographie plurielle, plaide ouvertement pour une nouvelle histoire nationale, connectée à des temporalités européennes et mondiales. Il sort du militantisme borné qui se limite à accuser les tenants d’une histoire nationale sans montrer ce que cette autre manière d’aborder notre passé peut apporter à la connaissance historique. Cette nouvelle expérience du temps, que l’historienne propose, ne peut que profiter, à notre sens, de l’étude du présentisme évoqué par François Hartog, qui mobilise les passés pour mieux les assujettir à un présent le plus souvent sans avenir.
© Yohann Chanoir pour Historiens & Géographes - Tous droits réservés. 29/10/2018.